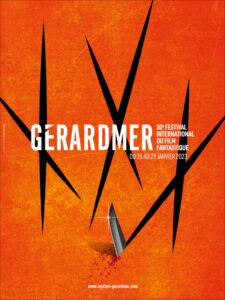Lorsqu’il se tenait à Avoriaz, le Festival du Film fantastique, longtemps le seul événement français du genre, attirait les caméras et micros des médias nationaux. C’était dans les années 1970-80, à une époque où les rédactions des quelques chaînes françaises trouvaient naturel d’accorder du temps d’antenne à l’étrange, à la science-fiction et à l’horreur. Tout cela a bien changé, aujourd’hui on ne risque pas de tomber, dans les Vosges fin janvier, sur des équipes de TF1 ou France 2. En 2023, il y avait pourtant plein de choses à faire savoir, par exemple que le festival fêtait sa 30e édition à Gérardmer, que le cinéaste coréen Kim Jee-won y a tenu une masterclass, qu’on y a organisé un hommage à Jaume Balagueró… et que l’événement a carrément battu ses records de fréquentation. Quatre jours de projections « sold out » pour une quarantaine de longs métrages, dont neuf en compétition. Retour sur ce qu’il y avait à voir cette année à Gérardmer.
BLOOD de Brad Anderson (États-Unis) — En compétition (film d’ouverture)

Le déracinement peut être source de traumatisme, en tout cas il fragilise les êtres et c’est sans doute pourquoi de nombreux films d’horreur racontent l’histoire de personnages sans repères ou presque, contraints de vivre dans un nouvel environnement. En instance de divorce, Jesse sait tout de même où elle met les pieds, dans une vieille maison de famille inoccupée, perdue dans la campagne américaine. Un retour aux sources qui lui permet de prendre ses distances avec son ex-mari infidèle et chercher un nouveau départ. Mais l’ambiance n’est pas à la fête : les enfants, surtout la grande, font la gueule, et le joli étang d’autrefois, non loin, n’est plus qu’un sombre marécage où trône la silhouette sinistre d’un vieil arbre mort.

Les films d’horreur sont à même de proposer plusieurs niveaux de lecture et, sous l’angle de la métaphore, de traiter de sujets graves de manière spectaculaire. Ici le petit garçon, Owen, tombe malade. L’infection se transmet par la morsure d’un chien revenu transformé d’une escapade jusqu’au fameux marécage, et l’enfant développe une soif inextinguible de sang humain. Faisant la preuve qu’on peut encore trouver des variations stimulantes sur le thème classique du vampire, Blood suscite la terreur face aux affres d’une mère prête à tout pour venir en aide à son petit, jusqu’à commettre des actes horribles qu’elle-même aurait auparavant jugés impensables. Abordé de façon réaliste, l’argument aurait donné lieu à une chronique familiale tragique où une maman serait accourue à l’aide de son fils toxicomane. L’addiction dépeinte par Brad Anderson (Session 9, The Machinist) inscrit sans détour le film dans le registre fantastique, et la finesse d’écriture autorise des touches d’humour qui, malgré la tension permanente, ne tombent jamais comme des cheveux sur la soupe. À l’issue de la projection, on se dit que Blood ferait un Grand Prix 2023 très acceptable, mais nous n’en sommes qu’au début de la compétition…
PIAFFE d’Ann Oren (Allemagne) — En compétition

Changement de style radical avec l’Allemande Ann Oren, artiste plasticienne formée aux beaux-arts à l’École d’Arts visuels de New York. Oren est venue au cinéma sur le tard, s’y intéressant depuis seulement 2015. Après deux courts métrages (dont Passage, en 2020, primé à Sundance), la néo-cinéaste signe Piaffe, premier long au titre en français — n’allez pas prononcer le mot à l’allemande, il s’agit bien du verbe piaffer ! Il est donc question de cheval, en l’occurrence l’animal filmé pour un spot publicitaire dont Eva doit assurer le bruitage en post-production. Pas une mince affaire : jusqu’ici simple assistante de son frère, indisponible pour cause de dépression nerveuse, la jeune femme a toutes les peines du monde à reproduire dans son atelier le son des sabots qui martèlent la sciure d’une écurie. Un taf qui vire à l’obsession, jusqu’à provoquer chez elle la croissance d’un appendice caudal chevalin nanti d’un fort potentiel érotique…
On n’a pas souvent l’occasion d’admirer dans les salles de Gérardmer des films à l’orientation ouvertement fetish. C’est le cas ici où les progrès d’Eva en matière de bruitages vont de pair avec un parcours sensuel où sa belle queue de cheval (voir l’affiche) joue un rôle essentiel. Tout en perfectionnant son art en studio, la jolie brune entame une relation de soumission avec un botaniste, un homme plus âgé amateur entre autres de shibari. Ainsi drivée, Eva, de nature timorée (et interprétée par Simone Bucio, aux faux airs d’Isabelle Adjani dans sa période Zulawski), s’initie à plusieurs rituels érotiques bizarres qui la mènent peu à peu à l’affirmation d’elle-même. D’où la force symbolique de cette invraisemblable queue de cheval que, dans un premier temps, elle camoufle avant de la laisser dépasser avec élégance et sans tabou de ses vêtements.

La découverte de cette ode à la déviance assumée s’accompagne d’un régal pour les oreilles comme pour les yeux. Forcément, avec un scénario pareil, la bande son est des plus soignées (et on se remémore Berberian Sound Studio de Peter Strickland, tout aussi insolite et présenté en 2013 à Gérardmer), de même que l’image, par sa texture même (le grain très visible est-il dû à un filmage sur pellicule ou est-ce un effet ajouté en post-prod. ?) comme par la composition du cadre, empli d’accessoires, de vêtements… aux couleurs soigneusement sélectionnées. Simone Bucio est très jolie, nantie de sa longue touffe de crin elle piaffe à son tour et les amateurs de pieds féminins écarquillent moult fois les yeux sur ses socquettes blanches. Gageons que le film aurait conquis cet autre grand plasticien érotomane qu’était le photographe Helmut Newton, allemand lui aussi, autant qu’il a séduit le Jury des longs métrages : au soir du palmarès, Piaffe remporte un Prix spécial mérité.
WATCHER de Chloe Okuno (États-Unis) — En compétition
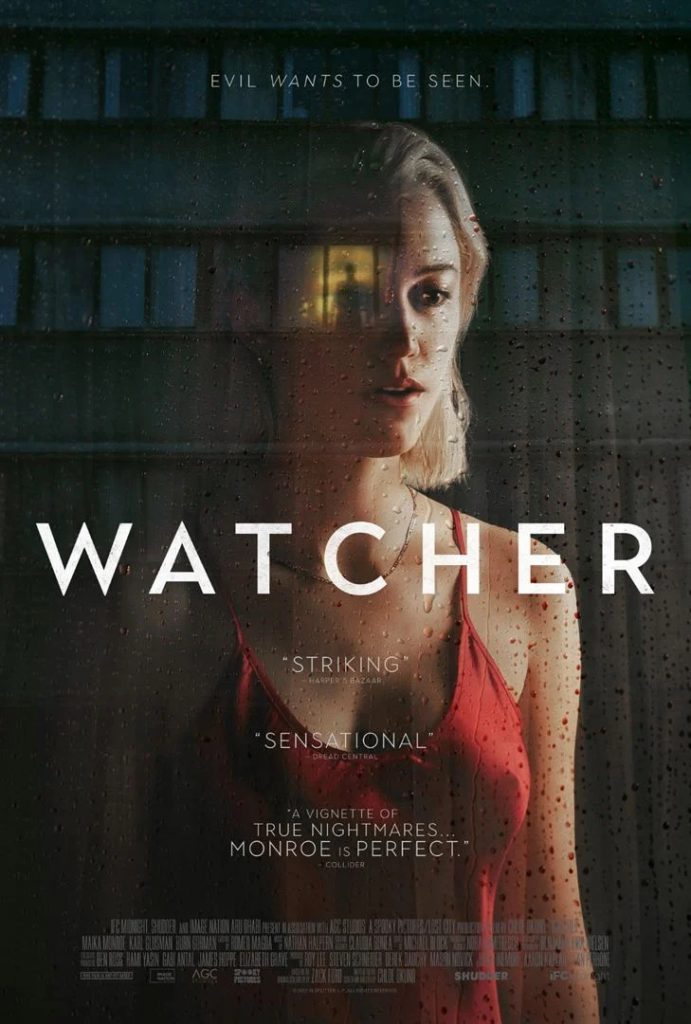
Retour à des œuvres de facture plus conventionnelle avec Watcher, où on revient aussi au thème du déracinement, dont nous parlions en début d’article. Julia, new-yorkaise, suit son mari Francis, d’origine roumaine, à Bucarest, où il vient de décrocher un poste à responsabilité. Francis parle couramment roumain, ce qui n’est pas le cas de Julia, immergée dans un environnement étranger où elle a le plus grand mal à communiquer. Par-dessus le marché, elle repère un voyeur dans l’immeuble d’en face, qui n’a de cesse de l’observer.

Julia, c’est Maika Monroe, l’actrice vedette du fameux It Follows, Grand Prix à Gérardmer 2015. Maika est de toutes les scènes et de presque de tous les plans, un parti pris logique puisque tout est raconté du point de vue de son personnage. Désœuvrée à longueur de journée, Julia imagine-t-elle qu’un inconnu l’observe ? La suit dans la rue ? à la supérette ? au cinéma ? Il faut dire qu’à Bucarest, la police est sur les dents, un tueur en série rôde. Et si c’était le voisin d’en face ? Le dispositif narratif n’est pas nouveau — l’héroïne qui, peut-être, interprète mal ce qu’elle voit et finit par passer pour une illuminée paranoïaque —, et le film n’a rien de fantastique (point de surnaturel ici, et tous les faits obscurs du récit auront une explication). Watcher s’est trompé de festival, c’est un thriller joliment photographié mais un peu mince, et bâclé in fine par un dénouement très abrupt.
LA TOUR de Guillaume Nicloux (France) — En compétition

Un film d’horreur français dans une tour HLM ! On a connu ça en 2010 avec le film de zombies La Horde de Yannick Dahan et Benjamin Rocher. Cette fois, c’est Guillaume Nicloux, réalisateur inclassable (notamment Le Poulpe, avec Jean-Pierre Daroussin, ou encore La Religieuse, d’après Diderot, en 2013), qui s’y colle. Auteur du scénario, Nicloux imagine un immeuble soudain coupé du reste du monde par un voile noir qui barre portes et fenêtres. Un voile noir ou plutôt le néant : passez-y un bras, vous ne le récupérerez pas. Bref, il n’y a plus d’issue. Les habitants — blacks, blancs, beurs — doivent se résoudre à vivre désormais en vase clos, en trouvant des terrains d’entente ou, le plus souvent — l’être humain est ainsi fait — en se bouffant le nez.

Guillaume Nicloux trompe les attentes de tous ceux qui, dans la salle, voudraient que les personnages cherchent à tout prix une explication à ce qui leur arrive, et surtout une sortie. Pas question de s’engager sur de tels rails : dans La Tour, pas d’espoir, no future — hommes, femmes et enfants sont enfermés dans un cloaque d’où ils ne s’échapperont pas. Les 90 minutes éclairées à la lumière crue des tubes néon (il y a quand même du courant !) se déroulent entre les murs de béton gris des appartements misérables et de plus en plus dégueulasses. Parmi cet échantillon d’humanité pathétique où les « communautés » s’affrontent, certains s’adonnent, pour tenir le coup, à une spiritualité de pacotille tandis que d’autres se livrent au cannibalisme (l’action s’étire sur des années, et le dialogue nous raconte que certains mangent des bébés conçus dans le seul but de servir de nourriture). Horrible, La Tour l’est certainement, on ne peut guère se plaindre de ça, mais c’est surtout un long tunnel de déprime nihiliste où l’on n’a que la mort (et la noirceur du néant) en point d’horizon. Qu’on le sache avant d’aller voir le film (sortie le 8 février 2023 dans les salles).
MEMORY OF WATER (VEDEN VARTIJA) de Saara Saarela (Finlande) — En compétition

Dans les files d’attente, les fans de science-fiction ont trouvé un sujet de discussion après avoir vu Memory of Water, anticipation post-apocalyptique où l’effondrement écologique de la Terre a provoqué la disparition de la flore et de la faune (ainsi que d’une partie conséquente des terres émergées, fonte des glaces oblige). L’eau potable est une denrée rare, et sa distribution est assurée par un gouvernement dictatorial qui maintient sous son joug la population assoiffée. Jusqu’à ce que Noria, maître de thé de son village comme le fut auparavant son père, ait la révélation de l’emplacement d’une source d’eau pure.

Comme si le péril climatique ne suffisait pas, Memory of Water (tiré du roman Fille de l’eau d’Emmi Itäranta, publié en France en 2015) préfigure à la fois les catastrophes écologiques et l’avènement de régimes totalitaires. Ce n’est vraiment pas gai, d’ailleurs le soleil ne se montre plus et, sans flore, tout est gris (la production finlandaise a planté ses caméras dans les plus beaux champs de cailloux de l’Estonie voisine). La réalisatrice Saara Saarela n’a pas bénéficié d’un budget énorme pour mettre en scène son quatrième long métrage, et le régime tyrannique se limite à l’écran à une douzaine de soldats en uniformes noirs. Cependant, malgré quelques invraisemblances, l’histoire est forte, et on admire la détermination tranquille de Noria, l’héroïne, qui pourrait bien bouleverser le système politique. La langue finnoise, les étendues caillouteuses baltes et certains physiques très scandinaves forment également un cocktail dépaysant pour les Européens de l’Ouest que nous sommes.
EN PLEIN FEU de Quentin Reynaud (France) — Hors compétition

Souvenez-vous, à l’été 2022, les feux de forêt ont fait rage dans les Landes. Obéissant à l’ordre d’évacuation, Simon (Alex Lutz) et son père Joseph (André Dussolier) prennent la route, rejoignant bientôt une cohorte de véhicules immobilisés au cœur du brasier. Assez vite, les deux hommes se retrouvent seuls, ils doivent abandonner leur voiture pour se frayer un chemin à pieds à travers l’enfer.

Rien de fantastique dans cette production qui part d’un drame vécu l’an dernier par des milliers de gens. La présence du film à Gérardmer est sans doute due à celle du comédien Alex Lutz dans le Jury des longs métrages (présidé par Michel Hazanavicius et Bérénice Béjo). Cela dit, l’atmosphère rougeoyante de fin du monde ne dépare pas dans la sélection. Comme son titre l’indique, En plein feu propose une immersion dans la fournaise, au milieu des cendres en suspension et des flammèches, une reconstitution qui autorise quelques passages étranges et des apparitions fantomatiques (tel ce petit groupe de pompiers aux abois, surgis des volutes de fumée pour y retourner aussitôt). Le scénario évite de se perdre en prouesses spectaculaires invraisemblables, et il ne se limite pas non plus à un « ride » à sensations : on apprend vite que le personnage de Simon a été frappé par un drame familial, et l’épreuve du feu pourrait être sa planche de salut pour surmonter un deuil et regagner l’estime d’un être cher. Un parcours de survie accrocheur, sans fioritures et bien rythmé, à découvrir en salles le 8 mars 2023.
LA PIETÀ (LA PIEDAD) d’Eduardo Casanova (Espagne/Argentine) — En compétition

Le distributeur français de La Pietà osera-t-il sortir le film en salles avec cette affiche ? Les paris sont ouverts. En tout cas, cette scène d’enfantement aberrant donne le ton, elle aurait pu être accouchée elle-même par l’imagination de Luis Buñuel, et le film dans son ensemble s’avère digne des échappées oniriques des mises en scène de Federico Fellini. Divorcée, Libertad vit avec son fils Mateo. Les deux ont développé une relation fusionnelle à tel point que leurs personnalités, parfois, se confondent. L’irruption de la maladie — une tumeur au cerveau — vient soudain perturber l’ordonnance lisse de leur existence.
Les programmateurs du festival ont pris quelques risques en admettant dans la compétition des œuvres d’auteurs résolument arty. Après Piaffe, les spectateurs ont pu s’ébaudir devant cette pietà dont l’existence même constitue une sorte de mystère : alors que les cinéastes trempant dans les univers imaginaires peinent en général à trouver des financements pour réaliser leurs projets, voici qu’arrive cet ovni au sous-texte psychanalytique limpide mais qui, dans sa forme, par ses partis pris esthétiques, ne ressemble à rien de connu ni de conventionnel. L’histoire se passe en 2011, une date choisie à dessein car elle coïncide avec la mort de Kim Jong-il, jusqu’alors « leader suprême » de la Corée du Nord. Le scénario jette une passerelle inattendue entre Pyongyang et Madrid et opère des allers et retours entre les deux pays, dressant un parallèle entre la relation mère-fils toxique, mortifère, et les rapports de domination-soumission qui lient le peuple nord-coréen au dictateur stalinien qui jour après jour le maltraite.

Il fallait y penser et, dans le fond, tout cela se tient. À Madrid, le cocon rose bonbon où évoluent Libertad et Mateo, tout comme les fringues de petit écolier que porte « l’enfant », presque adulte, n’ont pas de réalité objective : décors et accessoires correspondent à l’univers mental des deux personnages, coincés dans une relation où la mamá refuse de voir son fils autrement que comme un « pequeño » forcément dépendant d’elle. La Pietà est inconfortable et drôle, à la fois rose et noir, surréaliste dans sa forme (l’image de l’affiche est bel et bien tirée du film !) et pourtant étonnamment crédible dans le fond, avec un auteur parti du concept psychanalytique de syndrome de Münchausen par procuration (à vos dicos de psycho !) pour construire le double-portrait de ses personnages. Libertad au prénom ironique est jouée par Ángela Molina, vue plusieurs fois dans les films de Pedro Almodóvar et, pour en revenir à Buñuel, dans Cet Obscur Objet du désir, en 1977, où elle donnait la réplique à Fernando Rey et Carole Bouquet. Au dernier soir du festival, c’est un triomphe pour La Pietà, qui s’adjuge trois récompenses, dont la plus prestigieuse : le Grand Prix, ainsi que le Prix du Public et le Prix du Jury Jeunes de la région Grand Est, lesquels ont loué le film pour sa « dinguerie ».
THE NOCEBO EFFECT de Lorcan Finnegan (Irlande/Philippines/Royaume-Uni/États-Unis) — En compétition

Lorcan Finnegan n’a pas eu de chance il y a trois ans, lorsqu’est sorti son premier long métrage : après un passage remarqué à Gérardmer, le très réussi Vivarium est arrivé dans les salles françaises le 10 mars 2020, soit deux jours avant la décision gouvernementale de fermeture des cinémas pour cause de pandémie ! Une mésaventure qui ne se reproduira pas cette année : outre le fait que nous sommes maintenant presque tous vaccinés, The Nocebo Effect sera à son tour distribué début mars, mais cette fois directement en VOD. Si vous n’étiez pas dans les Vosges en janvier, c’est donc installé sur votre canapé que vous pourrez découvrir l’histoire de Christine (Eva Green), créatrice britannique de mode enfantine durement frappée par une maladie aux multiples symptômes, contre laquelle aucune thérapie ne fonctionne. Son salut pourrait venir de Diana, une aide à domicile philippine adepte de la médecine traditionnelle de son pays…

Lorcan Finnegan est reparti sans récompense de Gérardmer, ce qui ne veut pas dire que son film n’est pas bon, simplement que l’état d’esprit du Jury l’a plus fait pencher du côté du si singulier La Pietà. Car sinon, The Nocebo Effect est notre coup de cœur à nous parmi les titres en compétition, c’est une histoire solide, très bien racontée et servie par d’excellents comédiens. Le film suit le canevas de l’intruse qui, insidieusement, s’emploie à faire son nid dans le foyer d’une famille étrangère, dans un but connu d’elle seule et qu’on ne découvrira qu’au fil de la projection. Le scénario est très documenté (notamment sur les croyances des Philippins et leurs médecines alternatives) et la progression dramatique exemplaire évite tout manichéisme (entre Christine et Diana, peu à peu antagonistes, difficile, voire impossible de prendre parti, chacune se rendant coupable d’agissements condamnables). L’acte final édifiant enfonce le dernier clou et élève The Nocebo Effect au-delà du simple film d’angoisse en assénant un commentaire social d’une pertinence incontestable. Brillant sur toute la ligne. Et Eva Green est fantastique ! À lire, notre interview avec le réalisateur Lorcan Finnegan.
ZÉRIA d’Harry Cleven (Belgique) — En compétition
Visuellement, l’objet est peut-être le plus étrange de toute la compétition. L’image bleutée monochromatique nous dévoile le monde une fois que les humains l’ont déserté, tous partis coloniser la planète Mars. Tous sauf un individu, Gaspard, narrateur de l’histoire, qui adresse un monologue à son petit-fils Zéria, premier bébé à naître sur le sol de la planète rouge. Une voix off monocorde (presque sur le ton de la confidence), à l’exclusion de toute autre parole, et un film qui réclame au public d’accepter que l’histoire entière soit jouée par des marionnettes ou par des comédiens aux visages invisibles, grimés à la manière de pantins aux traits immobiles. Le narrateur nous fait entendre le récit de sa vie (il retrace en fait sa généalogie, de ses grands-parents jusqu’à lui-même), tout au long des 60 minutes, pas plus, de cet hybride entre film « live » et animation.

Au-delà de son propos, Zéria permet de questionner la tolérance du public d’aujourd’hui face à des œuvres faisant fi des canons narratifs et esthétiques auxquels il est habitué. Une heure de projection, ce n’est pas long, et pourtant l’expérience était trop exigeante pour un nombre conséquent de spectateurs qui, à partir de la mi-séance, le samedi après-midi, se sont mis à déserter la salle de cinéma du Casino, faisant claquer la porte de sortie une dizaine de fois. Une scansion fort désagréable (en plus du courant d’air froid !), qui gâche le plaisir de ceux qui restent, plus réceptifs au tempo contemplatif du trip proposé par Harry Cleven. En 2005, le cinéaste belge avait remporté le Grand Prix du festival avec son film Trouble, projeté de nouveau cette année (au sein d’une sélection thématique sur la gémellité — c’était l’occasion de (re)voir sur grand écran Faux-Semblants, Deux Sœurs, Bienvenue à Gattaca et d’autres). Il ne réitère pas la performance en 2023 mais il peut être heureux de nous avoir donné à voir un spectacle qu’on a peu de chances de voir ailleurs sur grand écran.
THE COMMUNION GIRL (LA NIÑA DE LA COMUNIÓN) de Victor Garcia (Espagne) — Hors compétition

C’est en masse et avec plein d’entrain que nous allâmes assister, le samedi soir à l’Espace LAC, à une cérémonie d’eucharistie pas comme les autres. Terre catholique, la péninsule ibérique associe souvent récit d’horreur et religion, d’où cette histoire de première communiante disparue qui revient hanter les habitants d’une bourgade espagnole. Le petit fantôme en robe blanche a tendance à laisser traîner sa poupée de communion. Si vous tombez sur l’objet, passez votre chemin sans y toucher, sinon vous êtes maudit !

On s’ennuie gentiment et il est déjà tard, mais comme on est dans de bonnes dispositions, on n’a pas à se forcer pour garder les yeux ouverts jusqu’au bout de ce teen movie, qui respecte un cahier des charges conformes aux attentes du public ado : héroïnes lycéennes (jouées par des comédiennes largement vingtenaires, on a l’habitude), scènes de danse en boîte, effets sonores qui blastent et jump scares en pagaille… jusqu’à une énième séquence de flippe dans les toilettes (brr, quelle est cette présence inquiétante dans la cabine voisine ?). La réalisation est efficace mais pas assez pour nous détourner des trous narratifs (telle cette punkette qui en vient à assassiner son père sans que personne ensuite ne lui demande de compte). Dernière précision, ça se passe dans les années 1980. Les gamers des années huitante retrouveront avec le sourire l’ambiance saturée de sons électroniques des salles d’arcade, à la faveur d’une séquence où l’on constate qu’il est possible de faire grimper la tension en passant à fond dans les enceintes la musique du jeu japonais Bubble Bobble.
MAD HEIDI de Johannes Hartmann et Sandro Klopftein (Suisse) — Hors compétition

On peut nourrir quelques scrupules à juger avec sévérité une œuvre qu’on sait avoir été créée avec les meilleures intentions du monde. Mad Heidi est de ce genre-là : montée patiemment en totale indépendance, avec une opiniâtreté sans faille des années durant, la production du film a été rendue possible grâce à une longue campagne de financement participatif. Des centaines de fans de cinéma de genre et d’exploitation ont mis la main à la poche pour rendre le tournage possible. 538 donateurs de francs suisses exactement, séduits par l’absurdité rigolarde du scénario, qui fait de la Confédération helvétique un régime tyrannique dirigé par un magnat du fromage ! Meili (c’est son nom) a mis tout le monde au pas et impose sa production d’emmenthal industriel dégueu à la population, ayant rendu illégale la fabrication de tout autre fromage. Suite à de malheureuses péripéties qui, d’un coup, la privent de son confort villageois routinier, la courageuse Heidi, fille des montagnes, va s’opposer au « very Swiss leader ».

Quelques festivaliers gérômois ont joué le jeu en débarquant avec de grands drapeaux suisses à l’Espace LAC pour savourer cette pochade à mi-chemin entre Iron Sky et les films grindhouse de Rodriguez et Tarantino. Le script ambitionne de relever à la sauce fromagère plusieurs sous-genres du cinéma bis, les films de zombie, ceux de kung-fu, ainsi que les WIP films — les films de femmes en prison. Une bonne partie du métrage se déroule dans un camp de redressement féminin mené à la baguette par la bien nommée Frau Rottweiler, et dans lequel échoue Heidi. Rottweiler est naturellement une peau de vache (et une de ses subordonnées s’avère encore plus sadique), mais en dépit de ce cadre sulfureux, la mise en scène reste sage, en tout cas dans les clous d’une interdiction aux moins de 12 ans, alors que le film sera vu en majorité, on s’en doute, par des gens habitués à des excès plus corsés (les fans d’Ilsa, la Louve des SS, levez la main !). Mad Heidi tient surtout de la grosse farce, pas très bien jouée ni franchement drôle, avec un sérieux problème de montage (quel rythme mollasson !), et le spectacle pâtit aussi de son budget tout de même restreint (à l’écran, la Suisse totalitaire a l’air d’une dictature d’opérette qui terroriserait à peine un demi-canton). Le dernier quart d’heure gore et fou-fou, un peu plus enlevé que le reste, sauve en partie la mise, mais pour un film dont on a pu suivre pas à pas la longue gestation (les auteurs ont teasé tout le monde en communiquant en permanence sur l’avancée du projet), le résultat n’est pas du tout à la hauteur de l’attente. Sachez sinon que Mad Heidi assure lui-même sa propre diffusion, étant visible en streaming payant (pour la modique somme de 9,90 euros) sur le site officiel de la production.
IRATI de Paul Urkijo Alijo (Pays basque) — Hors compétition

Les défenseurs du cinéma de genre et les gardiens de la culture basque ont trouvé un allié commun en la personne de Paul Urkijo Alijo, dont le premier long métrage Errementari fut présenté en 2018 à Gérardmer. Le cinéaste natif de Vitoria-Gasteiz (capitale de la province d’Alava) était aux abords du lac pour présenter sa deuxième réalisation, un film d’époque en costumes qui nous renvoie au huitième siècle, alors que les armées de Charlemagne envahissent les Pyrénées. Un chef local, à la tête d’un peuple de la vallée, parvient à repousser l’ennemi en faisant appel à la magie des dieux basques ancestraux. Une prouesse qu’il paie toutefois de sa vie, et son jeune fils Eneko sera envoyé loin de son village natal pour y être éduqué dans la foi chrétienne.

Incontestablement, voici une œuvre militante : Eneko devenu adulte revient en seigneur parmi les siens, et l’aventure qui l’attend — un périple en pleine forêt en compagnie d’une étrange jeune femme prénommée Irati — aura pour bienfait de le détourner des dogmes chrétiens, hostiles à toute autre foi, pour lui révéler la beauté et la bienveillance de Mari, déesse-mère primitive de la mythologie des Basques. L’odyssée de près de deux heures n’est pas exempte de quelques baisses de rythme, mais la vision est un enchantement : filmée par Paul Urkijo Alijo, la nature basque apparaît comme un sanctuaire d’une beauté presque irréelle, d’autant qu’on la découvre habitée par des esprits magiques aux mœurs sauvages, tels les lamies — femmes aux pieds d’animal — et les Jentilak, géants cyclopéens depuis longtemps considérés comme un symbole des peuples basques d’avant la chrétienté. Une escapade dans un monde merveilleux, naturellement interprétée en euskara, idiome millénaire, et saluée par des applaudissements nourris en fin de projection.
PROJET WOLF HUNTING (NEUGDAESANYANG) de Kim Hong-sun (Corée du Sud) — Hors compétition

Interdit aux moins de 18 ans dans son pays d’origine (ainsi qu’en Espagne, en Allemagne, en Australie, au Royaume-Uni…), Projet Wolf Hunting a été tourné par un réalisateur qui s’est vanté d’une forme de record : la production aurait utilisé pas moins de deux tonnes et demie de faux sang pour mettre dans la boîte ce carnage en pleine mer opposant dans la violence diverses factions de personnages. Un cargo transporte à son bord des détenus de droit commun coréens, jusqu’ici détenus à Manille et rapatriés dans leur pays d’origine. Les malfrats sont sous bonne garde policière, ce qui n’empêche pas un groupe armé de prendre d’assaut le navire pour mener à bien un projet d’évasion. Ce que tout le monde ignore, c’est que le bateau transporte aussi à fond de cale un spécimen dangereux de super-soldat, comme un combattant zombie né d’expériences japonaises menées au 20e siècle, quand l’Empire du Soleil levant poursuivait des ambitions guerrières expansionnistes.

Deux tonnes et demie de faux sang, donc, un stock qu’il a bien fallu écluser, quitte à faire de chaque scène ou presque un prétexte à faire couler l’hémoglobine. Alors il n’y a pas un gnon, pas un coup de feu ni un coup de couteau sans que le sang jaillisse en geyser ou se répande en larges flaques. Le spectacle est d’une outrance ridicule, infantile, sans compter que la scène est occupée par des personnages tous purement fonctionnels, sans épaisseur ni background, dont on se fiche bien de savoir ce qui va leur arriver. Des carences d’écriture rédhibitoires qui produisent l’effet inverse de ce qu’on pouvait espérer : Projet Wolf Hunting n’est ni Evil Dead ni Braindead, le festival gore ennuie au-delà de toute tolérance deux heures durant. Le « korean extreme cinema » nous avait jusqu’ici habitués à beaucoup mieux, pourtant cela n’a pas empêché la chose de trouver un distributeur français : Projet Wolf Hunting sortira dans nos salles le 15 février 2023.
VÉNUS de Jaume Balagueró (Espagne) — Hors compétition
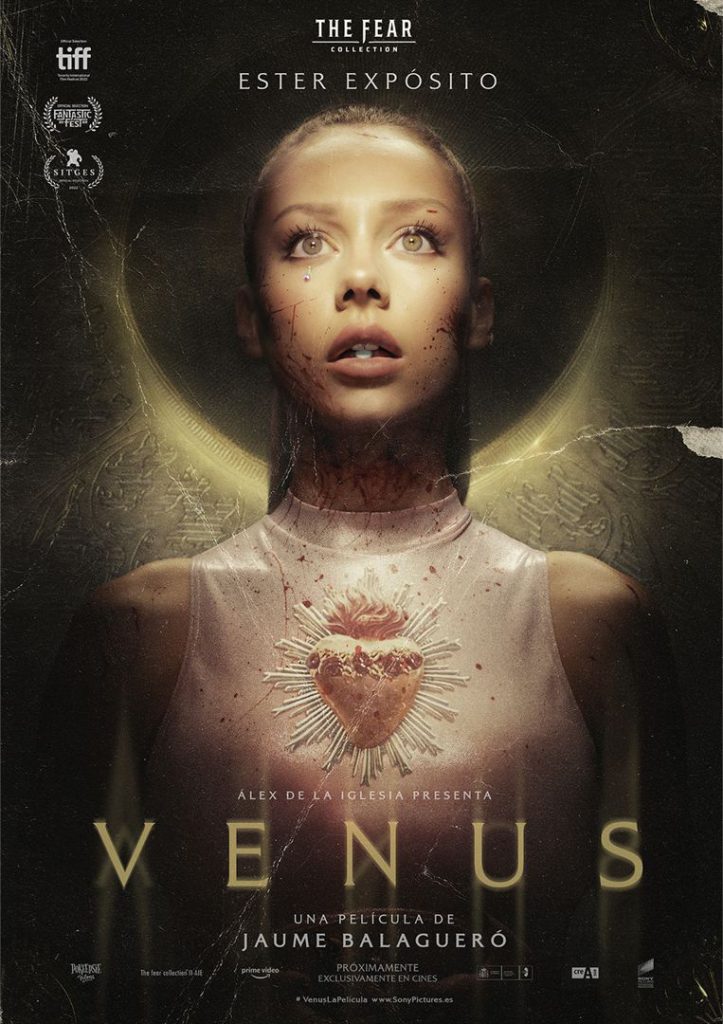
Gérardmer aime Jaume Balagueró, et l’estime est réciproque : le cinéaste espagnol a fait le déplacement à l’Espace LAC à chacune de ses « peliculas de terror » présentées dans la sélection, La Secte sans nom (2000), Fragile (2006) et [Rec] (2009), des titres tous primés au palmarès. Cette année, Balagueró n’était pas là pour prétendre à un prix mais pour prendre part à l’hommage que le festival lui a rendu. Dans les salles, on a pu voir ou revoir La Secte sans nom et [Rec], ainsi que Malveillance (2011) et, en avant-première, Vénus, sa toute dernière réalisation. L’histoire de Lucia (Ester Expósito), gogo-danseuse madrilène en cavale, prise en étau entre les mafieux qui l’emploient (à qui elle a dérobé un stock de drogue) et les adeptes d’un culte maléfique célébré en secret dans une vieille tour HLM.

Pas de sortie en salles prévue, c’est sur Amazon Prime Video qu’on pourra prochainement visionner Vénus qui, en plus de proposer un croisement étonnant entre horreur surnaturelle et film de gangsters, donne à voir ce que plein de festivaliers affectionnent : une héroïne forte qui sait encaisser les coups (il y en aura des durs, et de toutes sortes), une atmosphère mystérieuse et lugubre, des apparitions flippantes, plus ce cocktail toujours piquant associant gore et mysticisme occulte (déjà au menu de La Secte sans nom et [Rec], et on y regoûte avec plaisir). Parmi un casting composé avec soin, Ester Expósito donne de sa personne (danser, courir, frapper, ramper dans des flaques de sang ? aucun problème !) et Balagueró le lui rend bien, notamment dans le final ahurissant, où le réalisateur lâche les chevaux et, en quelques plans artistement cadrés, immortalise sa vedette en faisant d’elle une icone magnifique — icone de scènes d’action, puis d’horreur et enfin icone religieuse. On quitte la salle heureux, touchés par la grâce, convertis.

Est-ce bien tout ? Pas tout à fait : pour des raisons pratiques d’organisation qui n’appartiennent qu’à lui, l’auteur de ces lignes a choisi de ne pas se rendre aux projections de La Montagne du Français Thomas Salvador (récompensé au palmarès par deux distinctions, eh oui, le Prix de la Critique et le Prix spécial du Jury, ex-æquo avec Piaffe) et du film de clôture Knock at the Cabin, le petit dernier de M. Night Shyamalan. Qu’à cela ne tienne : l’un et l’autre films sont sortis le 1er février au cinéma, juste après le festival. Alors rendez-vous dans les salles et vous saurez ce qu’il faut en penser !
Pas de 30e festival sans les nombreux bénévoles, qui chaque année nous réservent le meilleur accueil dans les salles. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés, ainsi que Sophie Gaulier et Anthony Humbertclaude de SG Organisation et toute l’équipe du Public Système Cinéma.
Plongez dans nos archives pour retrouver les comptes rendus des précédentes éditions !