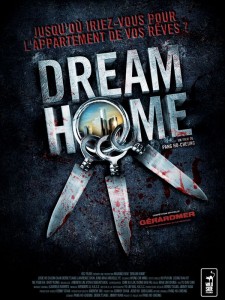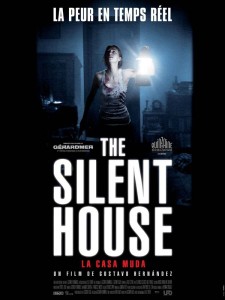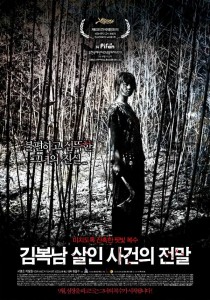« Schizophrénie, claustrophobie, paranoïa et autres petites joies de l’existence ». Le thème choisi pour la programmation de ce 18ème festival de Gérardmer aurait pu ouvrir grand la porte à une des œuvres majeures du fantastique de ce début d’année, à savoir le superbe Black Swan de Darren Aronofski. Hélas, point de cygne noir qui aurait donné du lustre à la sélection vosgienne 2011, mais une collection de longs métrages hétéroclite, dominée au palmarès par des titres qui, même s’ils relèvent du cinéma de genre, ne sont en rien des films « fantastiques »…
DEVIL (USA) de John Erick Dowdle (Film d’ouverture)
Le seul film américain de la compète doit son origine à M. Night Shyamalan. Le réalisateur de Sixième Sens, d’Incassable et, plus récemment, du pénible Dernier Maître de l’air, a imaginé une histoire à la Twilight Zone dans laquelle cinq personnages, qui ne se connaissent pas, se retrouvent prisonniers d’un ascenseur bloqué entre deux étages, dans un immeuble de bureaux de Philadelphie. Un point de départ qui rappelle un peu L’Ascenseur de Dick Maas, lointain Grand Prix de 1984, à l’époque où le festival se tenait à Avoriaz (et où sa programmation faisait les titres des grands journaux télé de 13h et 20h ! Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans, etc.). Cinq personnages dans la petite boîte, donc, c’est-à-dire un vigile intérimaire claustrophobe (pas de bol !), un vendeur de matelas, une retraitée, une nana bien mariée et un candidat à un entretien d’embauche. Malgré tous les efforts des équipes de sécurité (et de la police de la ville, venue là pour enquêter sur un suicide), pas moyen de faire repartir l’engin.
Devil a pour lui un personnage principal plutôt attachant (le détective Bowden, interprété par Chris Messina, vu notamment dans quelques épisodes de Six Feet Under), et une ou deux silhouettes secondaires qui ne le sont pas moins. L’action va bon train, rythmée par les hypothèses imaginées par le policier pour résoudre cette affaire d’ascenseur… hanté. Car pour le spectateur, cela ne fait aucun doute : il y a quelque chose de démoniaque là-dessous, comme le souligne avec insistance la voix off qui ponctue le récit. Ainsi le Diable himself aurait œuvré pour que la poignée de quidams se retrouve cloîtrée là, histoire de les faire mijoter un temps avant de les emporter en enfer. Et allez savoir, Belzébuth serait peut-être tout simplement l’un d’entre eux…
Une agréable mise en bouche pour les festivaliers, mais qui, au final, prête à sourire. Prétendre que les « méchants » en ce monde (soit de simples citoyens ayant deux, trois trucs pas jolis-jolis à se reprocher) sont guettés par un Lucifer prêt à les emmener rôtir relève d’une candeur moyenâgeuse difficile à prendre au sérieux. Le ton du film prend même un tour indigeste lorsque le final nous sert un prêchi-prêcha à base de péché, de pardon, de rédemption… Devil est prévu pour une sortie française en salles le 20 avril 2011.
DREAM HOME (Hong Kong) de Pang Ho-cheung
La deuxième journée du marathon filmique gérômois débute par les aventures de Mlle Cheng, employée d’une banque passant son temps à se faire rembarrer au téléphone par les clients à qui elle doit proposer des crédits à la consommation. La monotonie du job n’est brisée que par les pauses cigarette qu’elle partage avec quelques collègues un peu con-con sur les bords. Bref, c’est l’horreur, mais Lai-cheung (c’est son petit nom) tient bon, et elle enchaîne même, après ses heures à la banque, avec un job de vendeuse dans un grand magasin. Pourquoi un tel cumul ? Depuis l’expropriation dont sa famille fut autrefois victime, par la faute du gouvernement corrompu et des triades, Mademoiselle cultive une obsession : acquérir coûte que coûte un appartement dans un immeuble chic, avec vue sur la mer. Alors elle bosse, bosse encore, se prive de tout et épargne pour s’offrir son dream home. Mais dans la jungle spéculative de Hong Kong, s’échiner au travail ne suffit pas pour réaliser ses rêves…
S’appuyant sur la réalité de la crise du logement à Hong Kong, Dream Home justifie sa présence dans la sélection de Gérardmer par un fil rouge hilarant et, surtout, très, très gore. Alors que le portrait de Cheng nous est brossé au moyen de multiples flash-back (c’est l’occasion de faire connaissance avec les parents de Lai-cheung, avec son frère, avec son amant, un cadre marié qui pulvérise tous les records de goujaterie), le montage revient périodiquement sur l’instant T du récit, soit une soirée dans l’immeuble de standing tant convoité, qui devient le théâtre d’une équipée sanglante menée en solo par notre héroïne. Éreintée par ses démarches infructueuses pour devenir propriétaire, Miss Cheng finit par péter les plombs et entreprend de décimer une douzaine d’occupants de son futur palier, histoire d’entamer le prestige de l’immeuble et faire chuter le prix du mètre carré ! Le jeu de massacre fait tantôt grincer les dents (le meurtre de la fille enceinte), tantôt se taper sur les cuisses, le clou du spectacle arrivant avec l’équarissage d’un duo de junkies partouzeurs et de leur pote dealer. Le réalisateur Pang Ho-cheung plonge alors à corps perdu dans une outrance graphique limite Tex Avery, au mépris de toute vraisemblance. On se marre beaucoup, avant qu’une conclusion un poil amère ne mette un frein à l’hilarité en ancrant le récit dans le contexte d’une réalité qui fut dramatique pour beaucoup (la crise des subprimes).
NE NOUS JUGEZ PAS (SOMOS LO QUE HAY, Mexique) de Jorge Michel Grau
La mention du deuxième prénom du réalisateur est d’importance : on eût pu croire qu’il s’agissait d’un nouveau film de Jorge Grau, tout court, réalisateur espagnol d’une bonne trentaine de films, dont Ceremonia sangrienta/Cérémonie sanglante (1973), adaptation de l’histoire de la Comtesse Bathory (avec Lucia Bosé, maman de Miguel, dans le rôle-titre !), ou encore l’excellent Le Massacre des morts-vivants (1974). Mais non, el señor Grau, 71 ans cette année, a rangé ses caméras il y a un bail, et Ne nous jugez pas est le premier long métrage d’un jeune talent du cinéma mexicain.
Après quelques minutes d’errance hallucinée, un vieux bonhomme casse sa pipe dans un centre commercial. Le médecin légiste chargé de l’autopsie fera une drôle de découverte dans l’estomac de l’inconnu : un doigt féminin entier, avec verni à ongles, qu’il remettra aussi sec aux autorités ! Le spectateur apprend vite que le défunt était le patriarche d’une famille de trois enfants. Une famille très modeste, vivotant d’un petit stand de réparation horlogère et améliorant son ordinaire avec… de la chair humaine !
On imagine assez bien la pantalonnade sanglante que des réalisateurs comme Brian Yuzna ou Takashi Miike auraient pu tirer d’un sujet pareil. Sauf que l’ambition de Jorge Grau n’était pas de donner dans le gore festif, préférant exploiter le sujet du cannibalisme à des fins de commentaire social. Filmé en grande partie de façon nocturne, le Mexique ici porté à l’écran est sinistre, les petites gens y survivent en faisant le trottoir (les prostituées sont des silhouettes capitales du métrage) ou, pire encore, en s’entre-dévorant, le dialogue assimilant cette plèbe anthropophage à des « rats sur deux jambes ».
L’horreur de Somos lo que hay (« nous sommes ce que nous sommes ») se veut donc des plus réalistes, mais Jorge Grau pense néanmoins à ménager une part de mystère en laissant à notre sagacité des éléments essentiels à la compréhension du comportement des protagonistes. Chez les cannibales, il est ainsi souvent question d’un « rituel », de règles plus ou moins obscures que la mère de famille entend suivre — et faire suivre — à la lettre… Peut-être, tout simplement, doit-on voir là la nécessité d’un cadre normatif au sein duquel les mangeurs d’homme peuvent se considérer encore comme des êtres humains et non comme des bêtes… Œuvre austère, Ne nous jugez pas n’enflamme pas le public mais quitte les salles obscures gérômoises avec le Prix du Jury.
THE TROLL HUNTER (TROLLJEGEREN, Norvège) d’André Øvredal
En 2008, le festival de Gérardmer a programmé trois films très réussis fonctionnant sur le principe de la caméra-vérité, dans lesquels l’action est filmée sur le vif par l’un des personnages. Les trois films en question étaient Diary of the Dead, [REC] et Cloverfield. Ils reprenaient la formule initiée en 1979 par Ruggero Deodato dans Cannibal Holocaust, et dont l’idée fut reprise 20 ans plus tard par les réalisateurs du médiocre et néanmoins célèbre Projet Blair Witch.
André Øvredal choisit d’adopter le même principe. Un message introductif vise à nous faire croire que ce qui va suivre, constitué d’images brutes de décoffrage, sans montage, « authentiques », est le témoignage d’étudiants en cinéma partis filmer un chasseur de trolls dans la cambrousse norvégienne. Les premières images tremblotent, les gars en question (deux mecs et une fille preneuse de son) tripatouillant leur matériel pour s’assurer que tout fonctionne. Là, on a peur, on se dit qu’on est pris au piège, embarqués pour 1h30 de caméra secouée à la poursuite de créatures dont on n’apercevra que le bout de la queue ou de vagues silhouettes. Trolljegeren serait-il une arnaque à la Blair Witch Project ?
Eh bien non, pas du tout ! À la demi-heure de métrage, un petit miracle se produit : devant nos yeux émerveillés surgit un troll, un « vrai », mesurant 15 mètres de haut, avec trois têtes ! Et ce n’est que le premier d’une chouette brochette de spécimens dont on va tout savoir, ou presque, sur la vie et les mœurs (les « infos » à leur sujet, égrainées tout au long du métrage, sont hilarantes). À mille lieues de tout cynisme, André Øvredal invite les spectateurs à s’imaginer que, pour de bon, de très grands géants, puants et tout moches, au faciès grotesque, sillonnent les contrées scandinaves. À la faveur de la nuit seulement (ils sont mortellement sensibles aux UV), ce qui explique que personne ne les voie jamais ! Mais pour qui « sait regarder », les indices de leur présence sont évidents, souligne le chasseur de trolls, pour qui un arbre tombé à terre ou un bête éclat sur un tronc sont forcément dus au passage d’un Gollum maousse costaud… Et le mockumentary finit par prendre des allures de fable drolatique, poétique, que n’aurait pas renié le Monty Python. Je dis bien fable car il y a in fine une morale, soit une critique détournée de la manipulation des images — et donc du public —par les médias. Des créatures épatantes (et pétomanes), de l’humour, du contenu… Que demande le peuple ? Trolljegeren est mon coup de cœur du festival.
J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE (AKMAREUL BOATDA, Corée du Sud) de Kim Jee-Woon
Il y a un truc rigolo dans le cinéma de genre sud-coréen : depuis les succès d’Old Boy, de Memories of Murder ou, plus récemment, de No Mercy, les réalisateurs du Pays du Matin calme semblent s’être donné le mot pour tourner le polar ou le film de vengeance le plus cruel qui soit. I Saw The Devil (titre international du film) s’inscrit dans cette surenchère en imaginant les méfaits d’un violeur et tueur de jeunes femmes, Kyung-Chul, bientôt traqué par le compagnon de sa dernière victime. Ce dernier, Soo-hyeon, est un agent secret, il a tôt fait de localiser le tueur. Mais le veuf éploré ne veut pas se contenter de loger une balle dans le crâne du malfaisant. Ce qu’il souhaite, c’est faire endurer au tortionnaire mille fois les douleurs qu’il a infligées à sa victime…
J’ai rencontré le diable est dominé par la figure de Kyung-Chul (alias Choi Min-sik, interprète du héros d’Old Boy, vu aussi dans Lady Vengeance, tous deux de Park-Chan Wook). Le monstre exécute son horrible besogne sans aucun remords. « Par pitié, ne me tuez pas, je suis enceinte », supplie la pauvre fiancée du héros, au début de l’histoire. « Et alors ? », lui rétorque Kyung-Chul, étanche à tout sentiment, avant de l’exécuter froidement. Choi Min-sik apporte à ce personnage une intensité impressionnante, aidé en cela par son physique massif qui contraste avec celui, fin, presque juvénile, de Soo-hyeon. Tout au long du métrage, les deux êtres se croisent, s’affrontent, selon les règles d’un jeu du chat et de la souris orchestré par le jeune flic. Les sévices infligés par Soo-hyeon à Kyung-Chul à chacune de leurs rencontres vont crescendo, jusqu’à un dispositif particulièrement tordu imaginé pour la mise à mort. À la fin du récit, le malheureux policier, inconsolable après la perte de son amour, pleurera autant de larmes sur la fin de son innocence.
Le travail du réalisateur Kim Jee-Woon fut déjà distingué au terme de l’édition 2004 du festival, où son film Deux Sœurs remporta le Grand Prix. Une récompense qui lui échappera cette année, mais J’ai rencontré le diable triomphe tout de même au palmarès en raflant pas moins de trois prix (Prix du Jury Jeunes, Prix du Public, Prix de la Critique). Un succès qu’on pourrait qualifier d’amplement mérité pour cette histoire cruelle, extrêmement violente, à la mise en scène et au montage maîtrisés (le film est long, 2h22, mais on ne s’ennuie pas une seconde), si ce n’est que la présence d’un tel film dans la compétition me fait quand même tiquer : I Saw The Devil n’est pas un film fantastique et aurait davantage sa place dans un festival dédié au polar et au thriller. Sortie prévue dans les salles françaises le 6 juillet 2011.
THE LOVED ONES (Australie) de Sean Byrne
Succès également, lors de la remise des récompenses, pour The Loved Ones, qui s’adjuge de façon assez inexplicable le Prix du Jury Syfy et le Prix spécial du Jury (ex-aequo avec Ne nous jugez pas) malgré son absence totale d’originalité. Au pays des kangourous, on cause anglais et on paie en dollars (australiens), mais pas de quoi singer à ce point un certain cinéma américain. Le film de Sean Byrne cible le public ado et met en scène un personnage malaimé, Lola, qui n’a jamais trouvé grâce aux yeux d’un garçon du lycée. Elle aborde Brent, l’invitant à être son cavalier au bal de fin d’année. Une tentative vouée à l’échec car le beau gosse sort déjà avec Holly. Jusqu’ici, pas de quoi fouetter un chat, mais voilà : le narcissisme blessé de la timide Lola a évolué depuis longtemps en une psychose criminelle dont Brent va faire les frais au cours d’une longue nuit d’épouvante…
Doté d’une belle photographie en Scope, joué par des comédiens très impliqués dans leur rôle, The Loved Ones est une réussite formelle. Il n’est donc pas interdit d’y prendre un certain plaisir, mais mieux vaut n’avoir jamais vu Carrie de Brian de Palma, ni Massacre à la Tronçonneuse de Tobe Hooper, ni aucun titre d’une interminable liste de films US exploitant le thème de la famille de barjots homicides jetant leur dévolu sur d’innocents citoyens transformés en martyrs. Sean Byrne fait également siens les débordements sadiques de la récente vague de films de torture, Saw et Hostel en tête, et, dans son dernier acte, The Loved Ones va jusqu’à puiser son inspiration du côté du très fun Sous-Sol de la Peur de Wes Craven. Tourné il y a deux ans, le film est d’ores et déjà disponible en France en vidéo à la demande. À vous de voir si vous souhaitez risquer trois ou quatre euros dans l’affaire.
THE SILENT HOUSE (LA CASA MUDA, Uruguay) de Gustavo Hernández
Dans cette « maison muette », le réalisateur Gustavo Hernández s’amuse à relever un défi : mettre en boîte un film d’une traite, en shootant un plan-séquence de 80 minutes. Hitchcock avait réalisé cet exploit il y a plus de 50 ans avec La Corde. En réalité, le film avait été tourné en quatre plans, sir Alfred ayant été contraint de morceler les prises de vues à cause des inévitables changements de bobine. Depuis, les moyens logistiques ont changé : grâce à la vidéo numérique, plus question de s’interrompre de filmer. De la première à la dernière seconde, l’objectif colle aux basques de Laura, une jeune femme venue retaper une maison de campagne avec son père Wilson. Ils décident d’y passer la nuit avant d’entamer les travaux le lendemain matin…
« Inspiré de faits réels », The Silent House revisite le thème éternel de la maison hantée. Dans la baraque plongée dans l’obscurité (le courant est coupé), des bruits se font entendre à l’étage, le père de Laura trouve vite la mort et voici l’héroïne toute seule, lampe à la main, pour tirer l’affaire au clair. Dire que l’histoire passionne serait très exagéré. Il y a un twist, quinze minutes avant la fin, pas tellement surprenant, mais qui sauve l’intérêt qu’on porte au film en lui apportant une réelle densité émotionnelle. Avant cela, il aura fallu supporter de longues, très longues minutes de déambulation dans le noir, dans un labyrinthe de pièces encombrées et de vieux couloirs, un peu à la manière de… Silent Hill (le jeu, pas le film).
Dans la forme, le pari du plan-séquence unique est remporté haut la main, et on devine qu’il a fallu un travail dingue de préparation et de répétitions pour aboutir à ce résultat. Cela dit, les mouvements de la caméra portée sont parfois un peu trop voyants. Il y a en fait deux plans, le second, faisant office de conclusion, arrivant après le générique de fin (Gustavo Hernández trouve d’ailleurs un moyen astucieux de garder les spectateurs assis malgré le défilement des crédits). Un épilogue très touchant, qui fait mal au cœur. À ne pas rater, donc. The Silent House sera diffusé dans les salles françaises le 16 mars.
BEDEVILLED (KIM BOK-NAM SALINGSAGEONUI JEONMAL, Corée du Sud) de Chul-soo Yang
Tout comme J’ai rencontré le diable, le vainqueur du Grand Prix 2011 s’inscrit dans la mouvance de l’actuel « Korean extreme cinema ». Parfois ré-intitulé Blood Island, le film met en scène une micro-société insulaire dans laquelle débarque Hae-won, jolie trentenaire originaire de l’île mais qui a fait sa vie et sa carrière à Séoul. Des années après son départ, la citadine redécouvre la vie rurale de Moodo, de même qu’elle retrouve Bok-nam, son amie d’enfance. Cette dernière s’avère être le souffre-douleur de tout le village, qui l’a presque réduite à l’état d’esclave…
Une originalité de Bedevilled, outre un ton et une esthétique naturalistes, est son basculement de point de vue à la demi-heure de métrage : au départ héroïne du film, Hae-won devient personnage secondaire, le récit s’engageant dès l’arrivée sur l’île de Moodo sur les pas de la pauvre Bok-nam. La chronique de son quotidien prend des allures de mélodrame où rien ne lui est épargné. Bok-nam est mariée à un salaud qui, en plus d’avoir la main leste et le coup de pied facile, s’envoie en l’air avec des prostituées qu’il fait venir à grands frais du continent, au vu et au su de tous. Pour couronner le tout, l’homme a des vues sur la fillette de Bok-nam, qui finit par tenter une cavale avec l’enfant. L’échappée belle se solde par un échec cuisant et la mort de la gamine.
Face à ces horreurs, on prend naturellement fait et cause pour Bok-nam, l’indignation et le sentiment de révolte allant crescendo. Le récit, éprouvant, captive le spectateur, hélas seulement jusqu’à un certain point. La construction dramatique exemplaire de Bedevilled vacille en effet dans le dernier acte, lorsque l’héroïne sombre dans une folie vengeresse qui la pousse à exterminer ses tortionnaires. Les premiers coups de faucille sonnent juste, ils sont dirigés contre les vieilles harpies rétrogrades de l’île, mais le final, très maladroit, détonne avec tout ce qui a précédé en enchaînant des péripéties sanglantes involontairement tragi-comiques. Je n’en dirai pas davantage pour ne pas gâcher la surprise aux futurs spectateurs du film (le dvd de Bedevilled doit sortir en mai chez Wild Side). Tout de même, on quitte la salle de projection avec un sentiment de déception assez prégnant. Dommage.
Bilan…
Vous l’aurez compris à la lecture de ce compte rendu, Gérardmer 2011 n’a pas suscité chez moi un enthousiasme débordant, la faute à une sélection qui, en s’éparpillant entre thriller social, drame psychologique, film de vengeance, a tout bêtement perdu de vue la vocation fantastique du festival. Fort heureusement, les œuvres à portée purement imaginaire ont tout de même eu leur place dans cette dix-huitième édition, mais il fallait s’écarter de la compétition officielle pour aller jeter un œil dans les sections parallèles.
De bonnes surprises attendaient les festivaliers du côté des avant-premières avec la programmation d’En Quarantaine 2, la suite du remake de [REC], eh oui, dont je n’espérais rien de rien et qui m’a fait passer un bon moment malgré la projo en vidéo, ou encore de l’étonnant Rare Exports : un Conte de Noël du finlandais Jalmari Helander, récit iconoclaste où l’on s’intéresse au cas du « vrai » Père Noël, qui n’a pas grand-chose à voir avec le célèbre barbu habillé aux couleurs de Coca-Cola ! Le héros est un petit garçon courageux, et l’aventure surnaturelle qui l’attend va lui permettre de venir en aide à son papa tout triste, un veuf qui a du mal à joindre les deux bouts. Rendez-vous en famille pour la sortie du film dans les salles françaises, prévue à Noël ! Des œuvres plus dispensables étaient aussi au programme, comme Prowl de Patrik Syversen (Manhunt, sélectionné à Gérardmer en 2009), banal B-movie avec des post-ados jean+Converse séquestrés dans la remorque d’un poids lourd avant d’être jetés en pâture à des bipèdes carnassiers. Même topo avec le norvégien Cold Prey 3, où le dénommé Mikkel Brænne Sandemose succède à Roar Uthaug et Mats Stenberg, réalisateurs des deux premiers volets, pour mettre en images un slasher archi-classique qui a eu du mal à me faire garder les yeux ouverts malgré une projection en milieu d’après-midi !
Quelques mots, pour conclure, sur l’autre compétition de longs métrages de Gérardmer, à savoir la sélection des inédits vidéo. En vieil habitué du festival, je ne suis pas sans savoir que c’est souvent sur le petit écran de la Salle Paradiso, avec son plancher patiné et ses vieux fauteuils rabattables en cuir, que sont projetées bon nombre d’œuvres éminemment fréquentables (comme l’impayable Timecrimes, il y a deux ans, ou The House of the Devil en 2010). Bonne pioche cette année avec Triangle de Christopher Smith (Severance), très bon suspense à la Twilight Zone où la jolie Melissa George et ses amis se retrouvent prisonniers d’une boucle temporelle sur un paquebot fantôme. Le film décroche le Grand Prix (décerné par le public), qui aurait pu tout aussi bien échoir à l’excellent Terreur d’Anthony DiBlasi, éprouvante adaptation d’une nouvelle de Clive Barker. Le film vient nous rappeler, au besoin, que le cinéma d’horreur sait enfanter des œuvres franchement inconfortables, comme cette histoire où un étudiant s’aventure à confronter ses « amis » à leurs peurs les plus intimes.