Gérardmer, 26ème ! Les sélectionneurs n’ont pas créé l’événement en alignant des têtes d’affiche de la trempe de Grave ou de Ghostland (les vainqueurs incontestés des éditions précédentes), mais les meutes grelottantes de festivaliers ont pu se réchauffer tout en musclant leur esprit critique devant quelques excellentes surprises, venant notamment de Suède. Hors compétition, Oliver Afonso entame une histoire d’amour avec le public grâce à son jubilatoire Girls With Balls, tandis qu’Eli Roth et Udo Kier, en special guests, se sont vu consacrer des rétrospectives aux petits oignons — l’occasion de revoir Hostel et Cabin Fever sur les écrans vosgiens ou de découvrir en salle Chair pour Frankenstein et Iron Sky. Des questions ? Suivez le guide…
PUPPET MASTER, THE LITTLEST REICH de Sonny Laguna & Tommy Wiklund

(USA/Royaume-Uni — Compétition)
À moins d’être pourvu de la meilleure boule de cristal, il n’était pas évident de prédire la présence en compétition — et le succès au palmarès ! — de ce Puppet Master qui, a priori, n’a rien d’original : il s’agit ni plus ni moins du treizième titre de la série de films bis initiée en 1989 par David Schmoeller et Charles Band. Udo Kier succède à William Hickey, Steve Welles, Guy Rolfe… dans le rôle d’André Toulon, marionnettiste magicien créateur d’un régiment de poupées meurtrières, possédant chacune son propre look et son arsenal meurtrier pour décimer sa part du casting. Une fois dans la salle, on s’aperçoit que The Littlest Reich (écrit par S. Craig Zahler, réalisateur de Bone Tomahawk, Grand Prix du festival en 2016) présente quand même de jolis atouts. Après une chouette scène d’ouverture en flashback, située à l’époque du premier film, un splendide générique en bande dessinée résume la vie de Toulon et, en même temps, annonce l’activité du personnage principal, Edgar, à la fois auteur de comic books et vendeur en librairie spécialisée. Bien avancé dans la quarantaine, Edgar sort d’un divorce et retourne chez ses parents le temps de trouver un appartement et démarrer une nouvelle vie. Dans les cartons de sa chambre d’enfant, il tombe sur une des poupées démoniaques d’André Toulon…

Le film rassemble une galerie hétéroclite de personnages possesseurs d’un pantin fabriqué par Toulon, et qu’ils vont proposer à une vente aux enchères exceptionnelle. Tous séjournent dans l’hôtel où aura lieu l’événement, un choix de scénario bien pratique pour que s’engage un jeu de massacre intra-muros délirant où les marionnettes, s’animant les unes après les autres, sont à l’origine de séquences gorissimes. Le film est répétitif mais toujours drôle, macabre, habité d’un esprit Hara-Kiri qui ne recule devant rien (la scène scatologique de décapitation dans une cuvette de chiottes va rester gravée dans les mémoires !). Précisons aussi que Barbara Crampton est de la fête dans un second rôle, que le film dispense de généreuses rasades de discours sur la tolérance (en substance, homophobes et antisémites sont tous de la graine de nazi) et s’autorise même deux doigts de philosophie existentialiste qui ne gâche rien (« Dans la vie, beaucoup de gens morflent bien plus qu’ils ne le méritent. » — eh oui !). Tout cela faisait-il facilement un Grand Prix ? Réponse affirmative pour le duo grolandais de présidents 2019, Benoît Delépine et Gustave Kervern, qui ont peut-être usé de la menace pour convaincre leurs consœurs du jury Marie Gillain et Vanessa Demouy que les stars de Gérardmer, cette année, c’étaient les jouets sanguinaires de ce Puppet Master décadent et rigolard ! Le film s’adjuge aussi le Prix du Public.
ANIARA de Pella Kågerman & Hugo Lilja
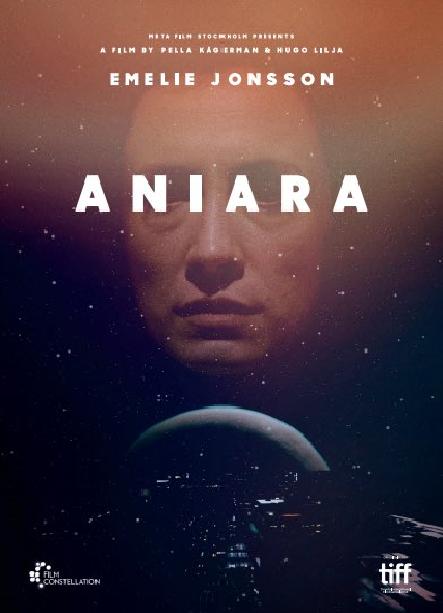
(Suède — Compétition)
Beaucoup plus sérieux, voici Aniara, adaptation d’un poème éponyme de l’auteur suédois Harry Martinson, lauréat du prix Nobel de littérature en 1974. L’œuvre fut déjà transposée à l’écran en noir et blanc pour la télé suédoise il y a 50 ans, et cette nouvelle version filmée entre en parfaite résonance avec notre époque, où les questions en matière d’écologie sont omniprésentes. Aniara imagine que, dans un futur encore lointain, la Terre est devenue invivable (plusieurs personnages présentent d’importantes cicatrices de brûlures, signes d’un rayonnement solaire meurtrier). Les humains s’embarquent massivement pour Mars, planète désormais colonisée qu’ils rejoignent dans de gigantesques vaisseaux spatiaux. C’est le cas de l’Aniara, navire suédois dans lequel vont se côtoyer des milliers de citoyens de tous âges. La traversée doit durer trois semaines, mais une avarie peu après le départ dévie le bâtiment de sa route et le condamne à filer sans espoir de retour vers les confins de la galaxie et au-delà…

« To boldly go where no man has gone before », c’était le credo de l’équipage de Star Trek, et par la force des choses, c’est celui aussi de la population de l’Aniara. Mais les Suédois n’ont ni Scotty ni Mr Spock sous la main pour les aider à redresser la barre et retrouver leur chemin. À vrai dire, le méritent-ils vraiment ? Le vaisseau n’est rien d’autre qu’un équivalent interstellaire de nos paquebots de croisière. À bord, tout est conçu pour le plaisir et le divertissement des passagers, qui peuvent reproduire le mode de vie irresponsable et consumériste sans doute à l’origine de la perdition de l’écosystème terrestre. Galeries commerciales, piscines, restaurants, nightclubs… Sera-t-il possible de trouver du sens à une existence entière dans cet environnement ? Vite réduits à un régime alimentaire à base d’algues cultivées à bord (beurk !), les personnages qui ne se suicident pas trompent le désespoir en dansant, en inventant de nouvelles pratiques spirituelles (certains initient un culte orgiaque ! Tant qu’à faire…). La trajectoire rectiligne dans le néant sidéral est à la fois pathétique et vertigineuse, et cette « Croisière s’amuse » tragique ne manque pas non plus de faire rire (jaune) grâce, entre autres, à des intertitres temporels qui nous donnent la mesure des mois et années qui passent avec des intervalles qui s’allongent, s’allongent… Bref, frères et sœurs humains du 21ème siècle, agissons pour que notre descendance n’ait pas à s’installer un jour dans un sarcophage volant ! Prix spécial du Jury.
THE UNTHINKABLE (DEN BLOMSTERTID NU KOMMER) de Crazy Pictures

(Suède — Compétition)
The Unthinkable n’est pas dû à une mais cinq personnes, des amis d’enfance qui ont un jour décidé de créer leur propre collectif, baptisé Crazy Pictures, au sein duquel ils entendent maîtriser toutes les étapes de la création d’un film. Après plusieurs courts, voici le résultat de leur premier projet de long métrage, dans lequel la Suède doit affronter la tentative d’invasion d’une puissance étrangère. Une manœuvre sournoise : pour paralyser le pays avant d’y envoyer les troupes, l’ennemi entreprend de saboter le système de distribution d’électricité et de couper également la communication par le biais d’une attaque bactériologique d’une nature inédite. En quelques heures, « l’impensable » se produit, le pays sombre dans le chaos…

Pas question d’ôter aux mérites de Puppet Master, mais The Unthinkable est la plus belle découverte de la sélection 2019, remportant trois trophées au palmarès (le Prix spécial du Jury — ex-æquo avec Aniara —, le Prix de la Critique et celui du Jury Jeunes). La mise en scène est percutante (avec des scènes de chaos automobile impressionnantes au cœur de Stockholm), mais le film est surtout admirablement écrit et raconté à hauteur des personnages, d’une richesse et d’une complexité inattendues : les auteurs prennent le temps nécessaire à conter le récit, sur plusieurs années, d’une famille disloquée par l’incommunicabilité (à petite ou grande échelle, c’est le thème au cœur du film) et dont les membres, face à la crise majeure que traverse le pays, vont réapprendre à se parler et à renouer des liens, ne serait-ce que pour quelques minutes… Aucun personnage n’est univoque, tous avancent dans l’existence avec leurs facettes obscures et leurs qualités lumineuses, et il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être touché par ce qui leur arrive.
The Unthinkable n’est pas à proprement parler un film fantastique, c’est peut-être ce qui lui a coûté le Grand Prix. Toutefois son scénario-catastrophe de politique-fiction déploie sous nos yeux l’hypothèse cauchemardesque, surréaliste et néanmoins plausible du saccage d’une grande démocratie de l’Union européenne… Si vous n’étiez pas à Gérardmer, ce chef-d’œuvre sera à découvrir non pas en salles, hélas, mais en DVD dès le 3 avril prochain.
LIFECHANGER de Justin McConnell
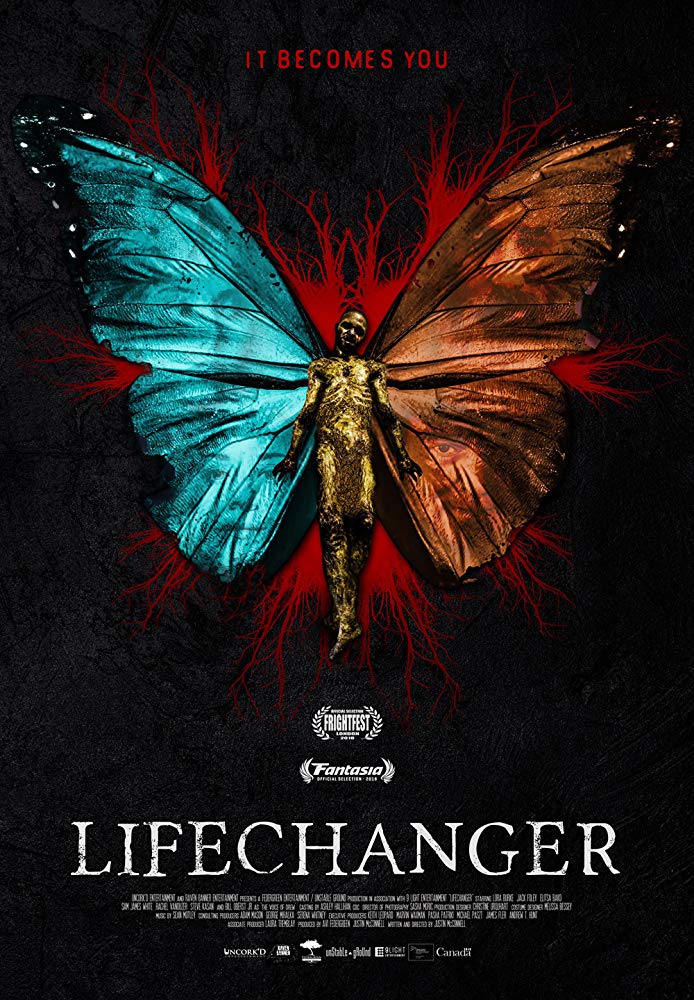
(Canada — Compétition)
Le thème/personnage du « shapeshifter » est une constante du cinéma de S.F. Le « métamorphe » (en bon français) est un extraterrestre (ou un être surnaturel) qui passe d’un hôte à l’autre, le phagocytant pour évoluer incognito parmi nous sous forme humaine. C’est le sujet des excellents Hidden (1987) de Jack Sholder, Le Témoin de mal (1998) de Gregory Hoblit (avec Denzel Washington) et bien sûr des emblématiques Invasion of the Body Snatchers (l’original de Don Siegel et ses trois remakes !) et The Thing de John Carpenter. Quoi de nouveau dans cette variation signée du dénommé Justin McConnell ? Partant peut-être du sage principe que, dans le genre fantastique, mieux vaut ne pas trop dévoiler les causes (histoire de ne pas gâcher les effets), Lifechanger impose un métamorphe qui, lui-même, s’adressant constamment à nous, s’interroge sur sa propre nature. La voix off masculine est la seule constante du récit, la « créature » devant abandonner rapidement les corps qu’elle imite car ils dépérissent une fois dupliqués.

Le titre est une bonne indication quant au propos du film : il n’est pas tant ici question de changer de corps que de changer de vie. En adoptant l’apparence de ses victimes, le « héros » (appelons-le quand même ainsi, d’un point de vue narratif) fait également sienne leur mémoire. Il peut ainsi s’installer, brièvement, dans la vie qu’il a usurpée, échangeant avec les relations de travail, la famille, les proches. Le ton du film et son rythme ne sont donc pas ceux d’un thriller (il n’y a ni enquête ni course poursuite, aucun personnage ne prend en chasse la créature pour contrecarrer ses agissements), mais plutôt d’un curieux mélange entre film de genre et « cinéma d’auteur ». Lifechanger s’interroge sur l’engagement (dans la vie de famille, de couple), sur la sincérité des relations humaines… L’œuvre n’est pas inintéressante, s’avère parfois troublante (quand elle aborde la question des changements de sexe), mais malgré quelques touches d’humour, le discours sérieux peut vite ennuyer.
ESCAPE GAME (ESCAPE ROOM) d’Adam Robitel

(Afrique du Sud/USA — Compétition)
Tout le monde n’a pas les dispositions nécessaires pour se débrouiller dans une partie d’escape game ! Il faut à la fois garder son calme et se montrer réactif, et mobiliser efficacement ses neurones même en état de stress. Les joueurs de cet Escape Room correspondent-ils au profil ? Par le sexe, l’âge, le statut social, la condition physique, les cinq héros sont en tout cas très différents les uns des autres. En outre, ils ne se connaissent pas mais tous ont cependant un point commun, celui d’avoir reçu une mystérieuse invitation à se livrer à ce fameux jeu coopératif qui a le vent en poupe…

Depuis les célèbres Cube (1999) et Saw (2005), on est habitués à ce type de scénario qui installe les personnages dans une mise en scène sado-ludique (ou ludo-sadique, c’est comme on veut). Suivant une mécanique très théâtrale (chaque étape franchie entraîne un changement d’acte/de décor, et fait sortir de scène un personnage), les héros se rendent compte que la partie qu’ils doivent jouer n’a rien d’anodin. Ceux qui, en coulisses, tiennent les manettes et tirent les ficelles poursuivent une ambition aussi obscure que meurtrière, et que le gagnant et unique survivant, s’il y en a bien un, aura peut-être le privilège de connaître… Escape Game a fait l’ouverture du festival, et il faut reconnaître que c’est une entrée en matière idéale : le dispositif n’est pas crédible une seconde (chaque décor piégé à explorer par les joueurs implique une logistique invraisemblable), mais les péripéties spectaculaires s’enchaînent à une cadence stimulante et les malheureux personnages, au background pourtant limité, constituent une collection de profils assez accrocheurs. Last but not least, le film puise aussi son carburant dans nos instincts les plus paranoïaques, et il ne manquera pas d’alimenter en matière à fantasme tout spectateur vif à se vautrer dans les plus délirantes thèses complotistes.
AWAIT FURTHER INSTRUCTIONS de Johnny Kevorkian

(Royaume-Uni — Compétition)
Les claustrophobes du public sont heureux que les sélectionneurs aient pensé à eux : Await Further Instructions est l’autre film, avec Aniara, à se dérouler entièrement en huis clos. Par comparaison avec le film de S.F. suédois, on change d’échelle : pas question ici de vaisseau spatial vaste comme vingt terrains de foot, les héros du film du britannique Johnny Kevorkian sont les sept membres d’une famille réunie pour le réveillon dans un très ordinaire pavillon de banlieue. La magie de Noël a du mal à filtrer, et tous ces sujets de la couronne sont prêts à se bouffer le nez à la moindre occasion. L’ambiance tendue empirera bien davantage au petit matin, lorsque tous découvriront de mystérieuses parois luisantes et inviolables, apparues dans la nuit et obstruant les sorties.

Le développement proposé par le scénario ouvre la champ à une nouvelle expérience ludique : coupés du monde, les héros reçoivent des instructions via l’écran de leur téléviseur. Jusqu’où accepteront-ils de les suivre ? Et ces messages, proviennent-ils du gouvernement s’adressant à l’ensemble de la nation ? C’est ce qu’on se dit dans un premier temps, puis les injonctions se font de plus en plus personnalisées et intrusives, comme si quelqu’un avait un œil dans la maison.
Logiquement, face à une crise exceptionnelle, les personnages devraient faire front et chercher ensemble une issue, en fait pas du tout : personne dans la charmante famille n’a de dispositions pour les escape games, et la situation ne fait qu’envenimer les rapports entre le papy castrateur, le père autoritariste et complexé, l’épouse inexistante, la fille raciste et débile et son petit copain à gros bras qui ne vaut pas mieux. Si ce n’était la présence des deux derniers quidams (le « bon fils » doux et tolérant et sa fiancée indienne), on prendrait volontiers fait et cause contre cet échantillon pitoyable de la société anglaise, fait d’individus incultes, bornés, conformistes et disposés à suivre n’importe quelle opinion, y compris fascisante, pourvu qu’elle soit relayée par un écran de télévision. Le message est clair, reçu cinq sur cinq, mais on en veut quand même aux auteurs, primo d’avoir pondu un scénario bourré d’incohérences (entre autres, les personnages se plient sans ciller à des directives médicales absurdes) et, secundo, de nous avoir infligé une heure trente de promiscuité avec des individus si antipathiques qu’ils suffiraient à convaincre n’importe quel europhile du continent à militer en faveur du Brexit !
ENDZEIT — EVER AFTER de Carolina Hellsgård
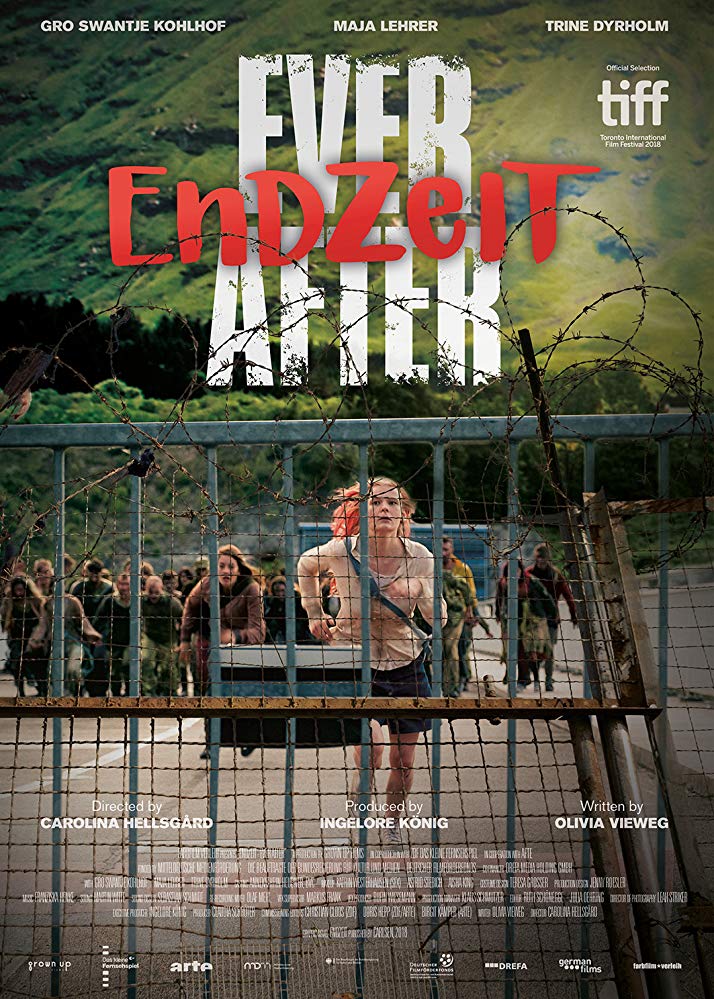
(Allemagne — Compétition)
Pas une édition du festival sans son histoire d’invasion zombie ! Après les très réussis What We Become (en 2016), The Girl With All The Gifts (2017) et le québécois Les Affamés (l’an dernier), voici Endzeit de la réalisatrice suédoise (mais établie à Berlin) Carolina Hellsgård. Les morts-vivants déambulent en maîtres dans toute l’Allemagne. Toute ? Non. Les villes de Weimar et Iéna constituent des poches de résistance. Interdiction absolue aux habitants des deux villes de sortir des enceintes protégées. C’est pourtant ce que vont tenter Vivi et Eva, deux jeunes femmes choisissant de quitter Weimar en douce pour rejoindre l’autre cité préservée.

« C’est un peu toujours la même histoire », entends-je râler à la sortie. On ne peut pas forcément donner tort aux mécontents : des héroïnes aux aguets, des monstres qui sprintent, la menace des morsures fatales… Les ingrédients respectent le catéchisme actuel du genre, et malgré quelques passages à suspense bien troussés, le canevas de road-movie pédestre avec zombies alentour a des airs de déjà-vu. À ceci près qu’il est inutile de chercher des personnages masculins : il n’y en a pas. C’est le concept novateur, et il se cache aussi derrière la caméra : tous les postes-clés de la réalisation — photo, décors, mise en scène, montage, scénario, etc. — sont occupés par des femmes ! La touche féminine s’exprime au travers d’une certaine langueur bucolique (sous le soleil, la campagne allemande est jolie) et d’un discours écologiste paisible qui prône un rapprochement salutaire entre l’humain et la terre nourricière, plus exactement le monde végétal. Comment donc pourrait s’accomplir cette osmose ? Les auteures illustrent leur idée de manière très poétique, un peu naïve, dans l’esprit d’un militantisme écolo tranquille, tendance hippie. Endzeit est sans doute le premier film de zombie entièrement féminin et certifié 100% bio.
DACHRA d’Abdelhamid Bouchnak

(Tunisie — Hors compétition)
La consommation de bidoche ne fera peut-être pas de nous des zombies, mais elle nous cantonne dans une position rétrograde, voire obscurantiste. C’est une des leçons qu’on pourrait aussi tirer de Dachra, étonnante production tunisienne se déroulant sur l’île de Djerba. Pas un touriste ni un palmier à l’horizon : Abdelhamid Bouchnak nous balade dans une Tunisie hivernale, de lieux urbains en forêts où, sous les pas des héros, crissent les feuilles mortes. Yasmine, Walid et Bilel sont trois étudiants en quête d’un reportage original à tourner pour clore leur cursus en école de journalisme. Un des garçons a eu vent d’une histoire de sorcière internée depuis des années en secret en asile psychiatrique. Le trio s’embarque dans un voyage au bout de l’effroi.

Abdelhamid Bouchnak a vu Le Projet Blair Witch, c’est fort probable, d’où la présence d’un carton en début de projection signalant que ce que nous allons voir est « inspiré de faits réels ». Le cinéaste entend brouiller la limite entre faits et fiction, mais son film se révèle bien plus substantiel que le « found footage » célèbre mais creux de Myrick et Sanchez. Il fait en tout cas beaucoup plus peur. « Dachra » est le nom d’un petit village archaïque perdu dans les bois, où finissent par échouer les reporters en pleine investigation. L’ambiance y est lugubre à souhait, les vieilles femmes restent mutiques et les plus jeunes se dérobent, le regard apeuré. Partout sont suspendus des quartiers sanguinolents de chèvres et de moutons. Une fillette a même l’air de goûter avec gourmandise la viande crue.
La pauvreté de moyens de la production est manifeste mais n’est pas gênante car le film ne cherche pas à séduire visuellement. Bien écrit, bien joué, le récit suit un schéma classique de l’épouvante selon lequel les personnages se jettent sans le savoir dans la gueule d’un loup. Une fois à Dachra, pas évident de repartir… La sorcellerie est à l’œuvre dans le village, pratique démoniaque qui, donc, s’accompagne d’une consommation friande de chair. Les images de marmites bouillonnantes et sales nous font plisser les yeux, les mâchoires croquent dans des portions à l’origine incertaine et la dévoration sans pitié d’un nourrisson à peine né finit d’ensevelir public et personnages dans les ténèbres. Du travail macabre joliment tourné et couronné par un dénouement habile qui nous cueille avec une chute à double détente réellement surprenante. Et attention : in fine, quelques lignes font écho à l’avertissement liminaire en nous apprenant que, chaque année, des enfants tunisiens disparaissent, enlevés à des fins de sorcellerie. Hem…
THE DARK de Justin P. Lange

(Autriche — Compétition)
Sans doute le film le plus sinistre de la compétition, mais pas le meilleur pour autant. La police aux trousses, un kidnappeur d’ado trouve refuge dans une bicoque délabrée dans les bois, avec, dans son coffre de voiture, sa dernière victime. Pas de chance pour lui : la demi-ruine est habitée — ou plutôt hantée — par une fille zombie jadis assassinée sur les lieux par son beau-père pédophile. La fille zombie massacre le kidnappeur à la hache et s’engage dans une relation d’amitié avec le gamin enlevé, qui est aveugle.

Pas de quoi rire, donc, dans cette production autrichienne (mais tournée en anglais au Canada) qui aborde le thème des abus perpétrés sur les enfants. Réal’ et scénariste, Justin P. Lange est sans aucun doute bourré de bonnes intentions, ce qui, suivant le proverbe, nous mène droit en enfer : à l’image de la masure déglinguée, le script est un véritable palais des courants d’air, avec des trous narratifs béants et un énorme problème de temporalité. La cécité d’un des héros (signifiée par un maquillage horrible ; celui de la fille morte-vivante n’est guère mieux) s’avère n’être qu’un artifice de scénario employé pour ménager une chute, du reste à l’impact bien modeste. Dur pour les deux jeunes comédiens (Toby Nichols et Nadia Alexander, très impliqués), mais The Dark est de ces films bancals et cafardeux qu’on oblitère aussitôt vus et dont on n’entend plus reparler ni dans les files d’attente, ni au palmarès.
L’HEURE DE LA SORTIE de Sébastien Marnier

(France — Hors compétition)
Dans la compétition comme en dehors, il est d’usage de ne présenter en festival que des titres inédits en salles, ce qui n’est pas le cas de L’Heure de la sortie, film sorti début janvier sur les écrans. Une programmation en séance unique (il fallait être debout le samedi matin à 9 h) justifiée par la présence du réalisateur Sébastien Marnier dans le jury de la compétition des courts métrages, où l’on trouvait aussi le trio de musique électronique Zombie Zombie, auteur de la bande originale du film. L’Heure de la sortie a pour théâtre un collège privé dans lequel le principal (joué par Pascal Greggory) a créé une classe d’excellence pour une douzaine d’élèves surdoués. L’année scolaire arrive doucement à son terme lorsque le prof de français du groupe d’élite (une classe de troisième) tente de se suicider en plein cours. Arrive Pierre (Laurent Laffite), un enseignant remplaçant…

La république française vit au rythme de ses années scolaires, et la grande tribu du « Mammouth » est un vivier inépuisable d’histoires et de personnages qu’exploite régulièrement le cinéma, la télévision, la bande dessinée… On n’est donc pas surpris de tomber sur un énième chef d’établissement d’allure rigide et de traîner une nouvelle fois dans une salle des profs où se côtoient des spécimens typés — le prof d’EPS joyeux drille, la prof de musique originale, etc. Adaptant un roman de Christophe Dufossé paru en 2004, Sébastien Marnier met aux prises son héros Pierre avec la fameuse classe d’élite, ou plutôt un sous-groupe de celle-ci constitué de six élèves au comportement étrangement atone, presque autiste. Les gamins, manifestement très intelligents, forment un bloc soudé et impénétrable. En dehors du collège, la bande se retrouve pour préparer en secret un mystérieux projet que Pierre, bientôt obsédé par ces jeunes hors norme, va s’employer à percer à jour.
Les dialogues brillants font réagir la salle, et Sébastien Marnier parvient à captiver l’auditoire avec un mystère tissé des peurs récurrentes de notre civilisation actuelle. La peinture du milieu enseignant et des relations profs-élèves ne sonne pas toujours juste, et le « climax » n’est pas à la hauteur de la construction dramatique par paliers, mais le film atteint malgré tout son but, faire sourdre l’inquiétude en brossant le portrait (imaginaire ?) d’une jeune génération trop lucide minée par une vision noire du monde et de ses dérives, qu’elle contribue du reste à aggraver en cédant à la tentation masochiste du fatalisme et du complotisme. Et Laurent Laffite, de toutes les scènes, est excellent.
BLACKWOOD, LE PENSIONNAT (DOWN A DARK HALL) de Rodrigo Cortés

(Espagne/USA — Hors compétition)
Découvrir une Uma Thurman brune en directrice de pensionnat, presque méconnaissable en tailleur strict, constitue l’une des seules raisons valables de se poser une heure trente devant ce Blackwood, production mineure signée Rodrigo Cortés (réalisateur remarqué du très conceptuel Buried, il y a dix ans). « Madame Duret » accueille avec son accent français une demi-douzaine de pépettes à problèmes dans son institution, un auguste manoir gothique à l’écart de la ville. Dès l’entrée dans les lieux, ça ne rigole pas : Madame confisque les smartphones (j’approuve !), impose le port de la jupette (allez !) et confie les demoiselles à un petit aréopage d’enseignants. Parmi les étudiantes, on retrouve Isabelle Fuhrmann, moins étrange que dans Esther, et la caméra suit surtout les pérégrinations de la blonde Kit, alias AnnaSophia Robb (mâcheuse de chewing-gum en 2005 dans Charlie et la chocolaterie). Faisant fi des consignes de la direction, Kit va fureter dans le manoir et mettre au jour les manigances des adultes. Le fond de l’intrigue fantastique part d’une interrogation insolite : s’ils avaient pu vivre 100, 200 ans de plus, les grands noms de la littérature, de la musique, de la peinture… auraient-ils continué à produire des chefs-d’œuvre, leur génie s’avérant intarissable ? Je ne nie pas qu’il y ait matière à débat, mais la question s’avère beaucoup trop oiseuse pour mobiliser la pleine attention des festivaliers après trois jours déjà de marathon filmique (Blackwood a été projeté le samedi).
RAMPANT (CHANG-GWOL) de Sung-hoon Kim

(Corée du sud — Compétition)
Y a-t-il encore des zombies dans la salle ? Oui, et ceux-ci paradent en costumes d’époque : la Corée médiévale et la cour du roi sont agitées par diverses affaires politiques, rumeurs de coups d’état et luttes de pouvoir. Rien de follement excitant pour l’observateur européen, mais on peut compter sur nos chers morts-vivants pour mettre un peu de piment dans tout ça. Sortant des cales d’un navire de marchand d’armes hollandais, une épidémie zombie fait bientôt des ravages dans toute la contrée. Le prince Ganglim, revenant d’une longue absence en Chine, flanqué de son fidèle serviteur eunuque, va avoir moult occasions de sortir l’épée du fourreau.

Rampant est le titre le plus exotique de la compétition, ce qui ne suffit pas à nous river à l’écran durant les 2h10 de métrage. 130 minutes, c’est long quand on se lasse vite des dialogues tantôt solennels (les sempiternels propos sur l’honneur, la loyauté et le devoir, d’une raideur toute asiatique), tantôt drolatiques (j’avoue rester perplexe face à la balourdise de l’humour, celui-ci étant l’apanage du personnage d’eunuque, maniéré et grimaçant). Heureusement, la réalisation énergique sauve en partie la mise lors de scènes d’action de grande ampleur impliquant les morts-vivants tous crocs dehors. Ces derniers ont par ailleurs un comportement un peu curieux pour des zombies, n’apparaissant que la nuit par crainte du soleil… À la fois un trait emprunté aux vampires et une commodité de scénario permettant aux héros de vaquer durant la journée sans se soucier des créatures. Les puristes n’apprécient pas forcément.
MANDY de Panos Cosmatos

(USA/Belgique/Royaume-Uni — Hors compétition)
Le « revival eighties » s’invite dans la sélection de Gérardmer avec Mandy : l’action du film se déroule en 1983, et le vieux logo Universal qui ouvre la projection ne laisse planer aucun doute quant au choix du réalisateur Panos Cosmatos de donner dans le faux vintage. J’ai déjà râlé dans nos pages contre des démarches artistiques semblables (Summer of ’84, Freaks of Nature et autres), mais ce coup-ci, je n’ai pas envie de faire la fine bouche : dominé (dans sa seconde moitié, surtout) par un Nicolas Cage totalement habité, Mandy relate les méfaits d’un groupuscule sectaire mené par un gourou comme on les déteste : quadra avec bagouzes et cheveux longs, le dénommé Jeremiah (Linus Roache) s’est constitué une petite cour itinérante de paumés qui n’ont rien à objecter à ses goûts pour la défonce et les abus sexuels. Au hasard d’une errance en mini-van le long d’une route forestière, le barjo tombe sur Mandy (parée du regard pénétrant d’Andrea Riseborough), épicière rêveuse qui vit à l’abri des tourments du monde avec son homme, Red (Cage), dans une jolie maison au cœur des bois, un sanctuaire où elle s’adonne au dessin et à la lecture de romans de fantasy. Rapt, torture, meurtre… Rendu à moitié fou par son soudain veuvage, Red entreprend une éprouvante croisade nocturne contre les assassins de la douce Mandy.

Présenté comme je viens de le faire, Mandy pourrait passer pour un ersatz sylvestre de Death Wish, mais non : le film n’a rien d’un « vigilante movie », il serait plutôt du style à passer en cinémathèque dans un cycle « 7ème Art halluciné » à destination des initiés, en complément parfait du Festin nu de Cronenberg, du Locataire de Polanski ou encore Eraserhead et Lost Highway de David Lynch. La photo noyée sous des couleurs surréalistes, le tempo et les dialogues archi-lents invitent à vivre la projo comme un trip sous LSD, électrisé ponctuellement par des convulsions gore qui, dans la salle, ont l’air d’être du goût de tout le monde. Quelques répliques ou costumes sont autant de clins d’œil, tous très bien amenés, à des classiques de l’horreur des années 1980 (Vendredi 13, Hellraiser, Massacre à la tronçonneuse 2…), mais d’un point de vue formel, Mandy se rapproche plutôt de certaines expérimentations picturales de Mario Bava ou, dans un autre domaine, des travaux du dessinateur Boris Vallejo. Autre influence : le rock’n’roll, version dure, s’impose comme la meilleure source d’énergie pour contrer les bassesses du gourou Jeremiah, aspirant popstar raté qui se serait bien vu en successeur des Carpenters ! Tout à sa mission vengeresse, Nic Cage se forge dans l’argent un outil invraisemblable, une sorte de hache-éperon de la forme d’une guitare psychédélique sur laquelle n’aurait pas craché Gene Simmons. L’instrument de mort perforera des gorges, des têtes vont aussi rouler. Mandy est un film ensorcelé et, dans l’âme, une œuvre purement heavy metal…
DEAD ANT de Ron Carlson

(USA — Hors compétition)
…et le film de Panos Cosmatos n’est pas unique en son genre dans la programmation puisque voici, sur un ton toutefois différent, Dead Ant, ineffable pochade à l’intention à la fois des fans d’horreur et des métalleux (qui sont souvent les mêmes personnes). « Le croisement entre Spinal Tap et Tremors », annonce l’affiche américaine, ce qui donne une idée juste de la chose. Soit les déboires de Sonic Grave, quintet de heavy metal en pleine déroute artistique : l’unique tube qu’ils peuvent porter à leur crédit est loin derrière eux, et leur pauvre manager Danny (Tom Arnold, génial) est bien le seul à se démener pour apporter au groupe un nouveau souffle. Un road trip jusqu’à un festival confidentiel en plein désert mojave pourrait ressouder les liens, booster l’inspiration. Oui mais : l’histoire a beau être une chronique rock’n’roll, Dead Ant se double d’un film d’agression animale. Les maîtres de la rocaille ne sont ni les Indiens, ni les cowboys (ni les fans de metal), ce sont les fourmis ! Et pas n’importe lesquelles : furieuses du peu de cas que les rockers font de la nature, les ouvrières à six pattes agitent leurs antennes et envoient contre les intrus leurs plus beaux spécimens, hyper rapides, aux mandibules tranchantes et gros comme des vaches !

Invité cette année au Salon du Livre du festival, Bernard Werber, s’il était présent dans la salle, n’a pu qu’acquiescer devant les quelques infos sérieuses sur les hyménoptères lâchées par le chanteur du groupe (qui doit toute sa science à l’émission de télé Jeopardy !). Pas dit, quand même, que l’auteur de la trilogie romanesque des « Fourmis » ait approuvé tout le reste, une accumulation de situations et dialogues nonsensiques où, en plus des bébêtes king size, pullulent aussi les allusions fendantes à la culture rock & metal. Secondé par un acolyte nain (Danny Woodburn, de Seinfeld, pas le moins drôle de la galerie), un vieux guerrier peau-rouge suit le spectacle de loin, les yeux emplis de sagesse, avant de sortir l’arc et les flèches pour porter secours aux gentils héros chevelus. Le cadre s’attarde aussi sur deux nénettes égarées qui ne se déplacent qu’en bikini, et le générique de fin défile sur un chouette morceau — de Sonic Grave, bien sûr — intitulé « Side Boob ». Masterpiece ? On aurait pu le chanter sur les toits si le film n’accusait pas un gros problème de rythme, avec plusieurs scènes redondantes, et s’il avait aussi cultivé jusqu’au bout son aspect chamanique (les musicos, à la recherche de l’inspiration, gobent des champignons indiens mais cela ne mène à rien). Enfin, la conclusion, bâclée par des scénaristes qui ne savent plus trop où aller, termine hélas le show sur une note mineure.
BEYOND BLOOD de Masato Kobayashi
(Japon — Hors compétition)
On entend beaucoup parler français dans cette production japonaise, et pour cause : Masato Kobayashi nous propose un documentaire sur la vague de la « French Horror » qui éclaboussa le monde de l’épouvante dans les années 2000, initiée par Haute Tension (2003) d’Alexandre Aja et abondée par À l’intérieur (Maury & Bustillo, 2007), Frontière(s) (Xavier Gens, 2007) et l’emblématique Martyrs (2008) de Pascal Laugier. Les réalisateurs de ces quatre films apparaissent maintes fois à l’écran, révélant dans quelles conditions leurs films respectifs furent conçus et accueillis, notamment dans les festivals de par le monde et… en France où, hormis chez les férus du genre, leur existence est restée confidentielle (Martyrs, au demeurant traumatisant, n’a attiré que quelques milliers de spectateurs à sa sortie !). Tous ne manquent pas de regretter l’étrange omerta sur le cinéma d’horreur produit dans l’Hexagone, révélatrice de l’état d’esprit du grand public, consommateur d’épouvante made in US mais défiant quand il s’agit de soutenir la créativité des auteurs nationaux.
Dans sa forme, Beyond Blood n’est pas tellement satisfaisant : plusieurs interventions sont redondantes (défilent les cinéastes précités mais aussi les deux comédiennes d’À l’intérieur, Alysson Paradis et Béatrice Dalle, ainsi que d’autres réalisateurs — Paco Plaza, Coralie Fargeat, Ted Geoghegan…) et on se demande même si on a bien sous les yeux un montage définitif tant sont nombreuses les carences techniques. Mais le fond du documentaire est toujours passionnant, les anecdotes nombreuses piquent la curiosité, et si on en vient à conclure que cette vague française de l’horreur n’eut rien d’une lame de fond et qu’elle est bel et bien passée, Masato Kobayashi pense à rattacher la série de films à une longue tradition sanglante (le fameux grand-guignol parisien) et il ne néglige pas de signaler l’émergence de nouveaux noms et de nouveaux titres — Grave (2017) de Julia Ducournau, Revenge (2018) de Coralie Fargeat — qui nous font garder la foi, les yeux tournés vers l’avenir…
GIRLS WITH BALLS d’Olivier Afonso
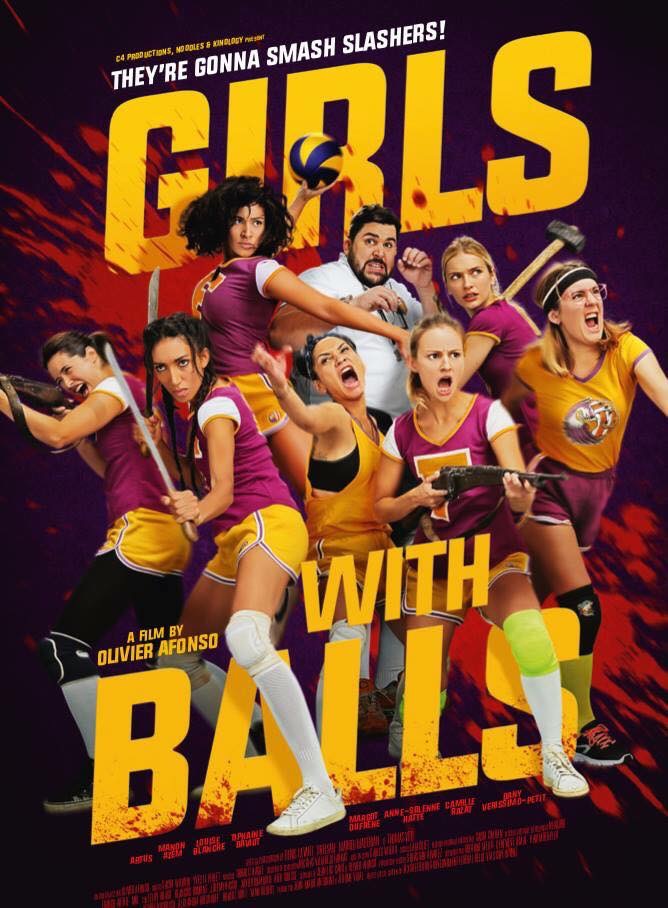
(France/Belgique — Hors compétition)
Et l’avenir, justement, parlons-en avec l’irruption parmi les réalisateurs de « French Horror » d’Olivier Afonso, jusqu’ici artiste renommé en matière d’effets spéciaux de maquillage et qui fait ses débuts de réalisateur avec cette énorme récréation fun et sanglante. Il est minuit sonnant le samedi soir lorsque David, le speaker officiel du festival, déboule sur scène déguisé en tyrannosaure pour introduire la traditionnelle « Nuit décalée », le sanctuaire des noctambules gérômois avides de spectacles dégénérés ! Un « double feature picture show » (comme on le chante dans le générique du Rocky Horror…) proposant au menu l’américain Dead Ant (voir plus haut) et ce Girls With Balls bien de chez nous (malgré son titre). Une heure trente de détente sportive dans laquelle une équipe de volley-ball féminine et leur coach, extatiques après la victoire d’un titre en championnat, se perdent en camping-car dans un labyrinthe de petites routes montagneuses. Les habitués du cinéma d’horreur se doutent que la suite ne s’annonce pas bien du tout… Le fait est que, non loin, s’agite une petite population masculine de chasseurs qui ne dégomment pas que les lapins de garenne ! Les filles devront mettre à profit toutes leurs compétences physiques et leur cervelle — et leurs « balls » ! — pour se tirer de là.

Le scénario-prétexte permet à Olivier Afonso d’aligner punchlines qui tuent et gags visuels sanglants. Girls With Balls est parcouru d’un très bon esprit, jamais racoleur, et l’énergie du film est communicative (dans la salle, tout le monde rit et tape des mains). Les comédiens sont aussi à la fête avec des numéros digne du grand-guignol : dans le rôle de l’entraîneur sportif, l’humoriste plantigrade Artus s’en prend à un chihuahua égaré (une scène qui a valu deux, trois remontrances au réalisateur, ha ha ! — lire notre entretien avec Olivier Afonso publié dans la foulée du festival) et Denis Lavant, loin des films de Leos Carax, retrouve les projecteurs du cinoche de genre tout juste un an après La Nuit a dévoré le monde et 20 ans après Promenons-nous dans le bois de Lionel Delplanque. Meneur du groupe de chasseurs, Lavant, hyper expressif, s’illustre dans un rôle muet de méchant où il fait passer toutes ses émotions par la pantomime. Face aux « bad guys », l’équipe féminine est composée de noms et de visages encore peu connus, même si certaines (Dany Verissimo-Petit, Anne-Solenne Hatte… les noms sont tous sur l’affiche) ont déjà des CV bien fournis, ayant à leur actif une riche collection de seconds rôles. Portant également le maillot, Tiphaine Daviot est quant à elle familière des spectateurs de la série à suspense Zone blanche, tournée notamment dans les Vosges et à Gérardmer ! Au moment où je publie ces lignes, la diffusion de la deuxième saison est en cours sur France 2. Tout cela pour bien faire comprendre — et histoire de paraphraser le titre d’un bon bouquin récemment sorti — que le cinéma (de genre) français, ce n’est pas de la merde !
C’est tout ? Presque : la compétition recelait un autre titre, The Witch : part 1. The Subversion, réalisation sud-coréenne de Hoon-jung Park qui repart de Gérardmer avec une récompense — le Prix du Jury Syfy — mais que je n’ai pas pu voir ! C’est comme ça… Hors compétition figuraient également au programme Ghost House, série B dont nous avons déjà parlé sur Khimaira (ici !) et Phil Tippett : Mad Dreams and Monsters, documentaire signé Gilles Penso et Alexandre Poncet (après l’excellent Le Complexe de Frankenstein) consacré à l’éminent spécialiste de la stop-motion à Hollywood. N’oublions pas non plus Zoo d’Antonio Steve Tublén, coproduction scandinave entre la Suède (encore !) et le Danemark, Meurs, monstre, meurs ! d’Alejandro Fadel (Argentine/France/Chili), que j’aurais pu voir si j’étais arrivé une heure plus tôt à Gérardmer (mais le timing des festivaliers est souvent si serré !), Freaks d’Adam Stein et Zach Lipowsky (dont j’ai entendu le plus grand bien — sortie prochaine en VOD) et enfin Mermaids, le Lac des âmes perdues, création russe de Svyatoslav Podgaevskiy que les derniers festivaliers ont pu découvrir en soirée de clôture.
Mes remerciements personnels et ceux de toute l’équipe de Khimaira à Anthony Humbertclaude et Sophie Gaulier (SG Organisation — Nancy), au staff du Public Système Cinéma ainsi qu’à l’armée souriante des bénévoles qui, comme chaque année, accueillent tous les passionnés que nous sommes avec la plus grande gentillesse et leur excellente humeur.

