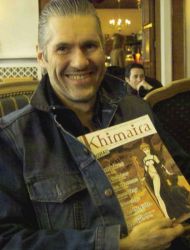Rencontre avec le cinéaste belge Harry Cleven, quelques heures avant qu’il n’obtienne le Grand Prix du 12ème Festival de Gérardmer pour son film Trouble.
Trouble aborde le fantastique de façon assez subtile – certains diront discrète –. C’est avant tout une histoire étrange…
Mon intention a été de construire un film effrayant à partir de mes propres peurs, qui sont des peurs identitaires. Le thème du trouble identitaire m’intéressait et, pour cette raison, j’ai choisi de raconter une histoire de jumeaux. J’ai voulu me mettre dans la peau de Matyas, qui découvre qu’il a un frère jumeau. Je trouvais que c’était déjà, en soi, une situation exceptionnelle car il se retrouve face à un double parfait qui, à 30 ans, entre dans sa vie.
Thomas se montre vite inquiétant…
Il y a un vrai paradoxe car c’est lui qui fait peur alors que son frère, le héros, a une apparence plus sombre et un caractère anxieux. Quand Thomas arrive, il est lumineux et plus beau que son frère – on a d’ailleurs maquillé Benoît Magimel pour qu’il ait l’air de dégager plus de lumière. Pendant tout le film, Thomas ne fait aucune erreur : il est doux, exemplaire, gentil, à tel point que cela le rend inquiétant, et Matyas va plonger dans une spirale paranoïaque : l’irruption de Thomas dans sa vie change la perception qu’il a de lui-même car il se regarde dans les yeux de sa femme et de son fils, et se dit qu’ils trouvent son jumeau mieux que lui.
Le jumeau apparaît alors comme un monstre…
Oui, d’où cette théorie, que j’ai inventée, selon laquelle les jumeaux lutteraient pour leur survie individuelle et se mangeraient l’un l’autre. J’aime beaucoup l’idée du monstre à l’intérieur, qui rompt avec cette image d’Épinal représentant les jumeaux comme un couple parfait. Lorsque tu interroges vraiment les gens, tu te rends compte qu’il peut y avoir des histoires de haine incroyables entre jumeaux. J’ai poussé cette haine jusqu’à imaginer une lutte qu’ils se livreraient dans le ventre même de leur mère, où il n’y aurait pas forcément assez de nourriture pour les deux. Alors l’un prend tout et l’autre finit absorbé. Il ne subsiste de lui que l’ombre du fœtus, comme il est dit dans le film. La scène de bagarre reproduit cette lutte métaphysique éternelle, et la situation finale symbolise cette théorie de l’absorption puisque l’un des deux frères intègre l’autre en lui.
Les deux gamins qui jouent le rôle de Matyas et Thomas dans les flash-back sont étonnants. Ils ont l’air eux-mêmes de créatures fantastiques, avec de grands yeux.
Ils sont incroyables. On a fait un grand casting d’enfants jumeaux et on s’est d’ailleurs retrouvés confrontés à un drôle de problème : souvent, l’un jouait bien la comédie et l’autre pas. On a dû faire un gros travail de préparation avec les deux qu’on a retenus : un coach leur a appris à se mettre en situation. Mais ils avaient une tête tellement étrange, c’étaient de vrais extraterrestres ! Et, sur le plateau, ils avaient l’air toujours très fragile, un peu flippé. Ces deux mômes sont dans la réalité aussi bizarres que dans le film et ils ont vraiment contribué à l’aspect décalé et onirique du film.
Cet aspect onirique résume-t-il ton approche du fantastique ?
Je préfère, c’est vrai, quand les choses sont étranges, suggérées, qu’il y ait cette sorte de glissement vers une autre dimension, vers quelque chose qui est de l’ordre de la perception et qui fasse peur sans qu’on comprenne vraiment pourquoi. C’est ce que j’aime, par exemple, dans la littérature de Philip K. Dick, où un personnage met le pied dans un monde parallèle tout en restant très proche de la vie normale. C’est une question de goût, mais je trouve cela beaucoup plus effrayant que des films où le sang gicle et qui sont, peut-être, plus ludiques. Les films où le monstre est un personnage à part entière ne font pas réellement peur et sont même assez rassurants car ils n’impliquent pas les spectateurs et sont inoffensifs. Dans un film où le monstre n’est autre que soi-même, on est confronté à sa propre violence et là, ça devient vraiment effrayant. Bien sûr, c’est une peur qui se joue à un niveau psychanalytique et qui, forcément, ne donne pas lieu à des mises en scène spectaculaires. Mon film, du coup, ressemble peut-être davantage à un thriller psychologique qu’à un « film fantastique ». Il fait peur, mais l’angoisse qu’il provoque est avant tout liée à l’étrange.
La structure de Trouble illustre également le thème de la gémellité, car le film est construit en miroir.
Tout ce que fait Matyas, Thomas le fait aussi de son côté. Il va voir la femme de son frère et, quand il revient à la maison, s’aperçoit que Thomas est venu voir la sienne. Tout est comme ça, effectivement, construit en miroir. Cela dit, la caméra adopte toujours le point de vue de Matyas. Il n’y a donc jamais de confusion ni de scène où l’on voit Thomas en Matyas. La seule scène ambiguë de ce point de vue est celle où Natacha Régnier met Petit Pierre au lit et où, semble-t-il, Thomas apparaît sans son frère.
Du point de vue technique, avoir Benoît Magimel doublement présent dans le cadre a dû compliquer énormément le tournage. Jusqu’ici, la référence absolue en matière de clônage de comédien était Faux Semblants, de David Cronenberg…
J’ai bien sûr regardé Faux Semblants pour être certain de ne pas en faire le remake. En fait, dans ce film, il n’y a que deux séquences où les jumeaux sont présents côte à côte car, à l’époque, les techniques ne permettaient pas de faire davantage, et une doublure remplaçait Jeremy Irons dans tous les plans où un jumeau se tenait de dos. Le film a donc vieilli et j’ai vraiment tenu à aller plus loin. Pas mal de gens dans les boîtes d’effets spéciaux ont fait la grimace et m’ont prévenu que le tournage allait être très lourd. Finalement, je suis tombé sur quelqu’un qui m’a dit que c’était faisable, à condition, notamment, de travailler avec de longues focales et sans avoir de rapport au sol. J’ai donc pu élaborer ma mise en scène comme si le film devait se tourner avec deux acteurs. Après, on a filmé avec deux caméras : la première était la caméra principale et suivait l’acteur, l’autre était une caméra de surveillance qui suivait à la fois les mouvements de l’acteur et de la première caméra. On a ensuite fait un travail de simulation en 3D en redécomposant tous les plans. Ça a été très compliqué, mais puisque c’est filmé à hauteur d’épaule, l’illusion fonctionne. On a bien sûr dû faire un important travail au niveau des yeux car il fallait, à chaque fois qu’il y a interaction entre Matyas et Thomas, que les regards tombent au bon endroit et au bon moment. Il fallait également que Benoît Magimel se repère dans chaque plan, qu’il fasse correspondre ses réactions avec les dialogues de l’autre. Mais le jeu en valait la chandelle parce que ça n’avait jamais été fait auparavant. On a montré le travail fini à plusieurs boîtes d’effets spéciaux et personne ne comprenait comment on avait pu arriver à ce résultat.
Sinon, dans le domaine du fantastique, avec quels cinéastes as-tu des affinités ?
J’aime beaucoup les films de David Lynch, où, d’ailleurs, les choses ne sont jamais franchement fantastiques et dans lesquels on retrouve ce côté onirique et décalé auquel je tiens. Le film Solaris, d’Andrei Tarkovski, est également l’un des plus beaux que je connaisse. C’est une œuvre d’une grande étrangeté dont on en sort complètement déboussolé. Enfin, je dois reconnaître que, quand j’étais plus jeune, j’étais un vrai fan de films de vampires et, encore aujourd’hui, j’aimerais bien en tourner un. Mais je ne ferais sans doute pas un film sanglant. Je raconterais plutôt une histoire avec des gens qui prendraient l’énergie des autres. Ce serait une tentative d’ancrer dans la réalité le personnage du vampire… En fait, les grands films de vampires sont, pour moi, des histoires d’amour. On a un homme qui traverse le temps, comme dans le film de Coppola, pour retrouver la femme qu’il aime, mais c’est un amour impossible car s’il l’aime, il la tue. Je trouve ça magnifique, c’est très romantique, très beau. C’est une thématique propre au personnage du vampire et, en fin de compte, peu de films l’abordent.
Remerciement à Séverine Lajarrige