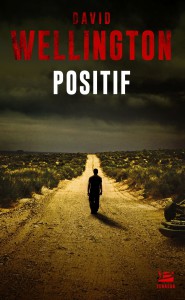Mutique et le pas traînant, le mort-vivant n’a pas vraiment l’étoffe d’un héros littéraire, d’où la difficulté de faire porter sur ses épaules le poids d’une grande intrigue romanesque. Non pas que la chose soit impossible (souvenons-nous, par exemple, du sympathique Vivants/Warm Bodies d’Isaac Marion), mais ce n’est pas ici l’ambition poursuivie par David Wellington (auteur, déjà, de la trilogie Zombie Story, parue il y a une dizaine d’années). Dans Positif, les macchabées animés ont beau hanter le monde, ils demeurent de simples figurants dans le théâtre de l’horreur post-apocalyptique imaginé par le romancier américain. L’histoire est celle de Finnegan, 19 ans, né bien après qu’un virus a réduit les humains à l’état de cannibales en putréfaction. Finn n’a jamais vécu qu’à Manhattan, il y a ses habitudes, ses amis, ses repères, et il se verrait bien passer une vie entière sur ce grand îlot clôturé où pas un zombie n’est venu rôder depuis des années. Oui, mais : des circonstances aussi dramatiques qu’imprévues font de Finnegan un « positif », autrement dit un citoyen contaminé et susceptible, d’un jour à l’autre, de virer zombie (la maladie peut mettre jusqu’à vingt ans à incuber). Marqué d’un « + » tatoué sur le dos de la main, Finn se retrouve rejeté sur le continent. Destination : un camp sanitaire dans l’Ohio, mais rien ne va se passer comme prévu.
L’argument du virus changeant les humains en monstres est un peu trop commode, d’autant que David Wellington ne se donne pas la peine d’en expliquer l’origine. L’auteur capitalise sur le fait que les lecteurs du genre, rompus à ce type d’histoire, vont gober sans broncher le postulat de départ (et le fait est que, de nos jours, le thème du zombie est presque toujours abordé sous un angle scientiste, faisant des morts-vivants les rejetons d’un agent pathogène plutôt qu’une émanation de l’enfer). Admettons, mais alors la nécessité de faire du fléau une contagion zombie est purement théorique, et l’on se dit que l’auteur aurait pu accoucher d’un roman semblable en prétextant toute autre épidémie mondiale, due par exemple à une souche de grippe ravageuse. Les dangers nombreux que va affronter Finn, notre héros, viennent rarement des cadavres ambulants, mais plutôt des humains : tantôt pillards ou fanatiques religieux, tantôt militaires haineux œuvrant sous couvert de la loi martiale, les survivants du désastre constituent des groupes potentiellement hostiles, prêts à tout pour assurer leur subsistance, et le roman relate principalement la lutte du héros contre cette adversité bien humaine.
Tronçonné de façon insolite en 150 minuscules chapitres (jamais plus de quatre pages !), Positif déroule une narration simple et efficace, à la première personne, sans grands effets ni trésors de langage. Un style économique, un peu sec, mais qui convient assez bien à ce « bildungsroman » doublé d’une chronique où l’humanité, qui doit tout reprendre de zéro pour se reconstruire, traverse les affres de la précarité. Dévastés et désertés, les États-Unis explorés par le héros donnent à David Wellington l’occasion de reprendre à sa manière des sous-catégories bien connues du cinéma ou de la littérature de genre : en début d’histoire, l’île de Manhattan enclavée fait songer à Escape From New York de John Carpenter, puis le récit s’évade à la manière d’un road movie à la Mad Max avant de marquer un arrêt le temps d’un long épisode où Wellington revisite le film de prison. Attendez-vous aussi in fine à deux cents pages s’apparentant avec évidence au western. À défaut de proposer une lecture à 100% accrocheuse (l’auteur parvient à surprendre mais ne cherche jamais à créer d’insoutenables moments de suspense), Positif demeure néanmoins un bouquin très fréquentable, peut-être pas pour les inconditionnels des zombies, en tout cas pour l’amateur de S.F. post-apo.
Après une première parution en 2015, Positif en réédition poche est disponible depuis le 19 septembre 2018.